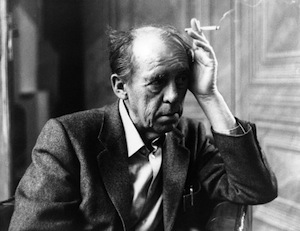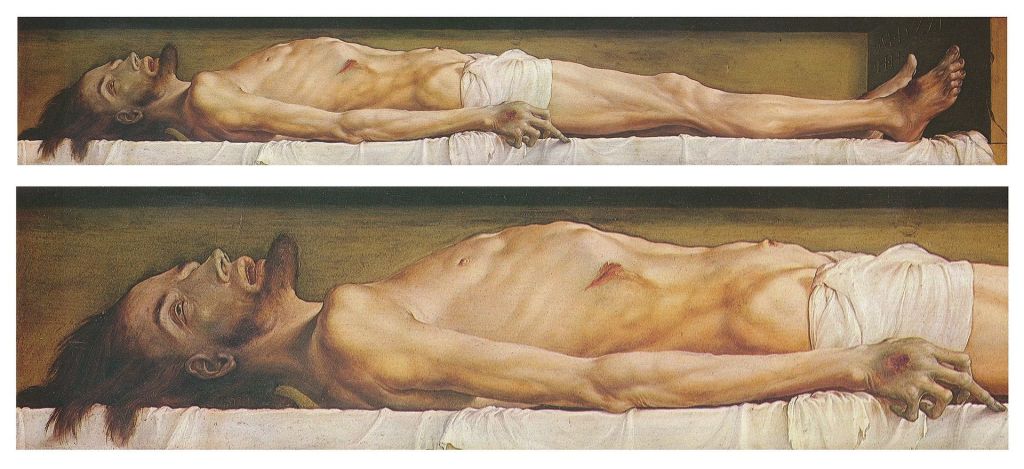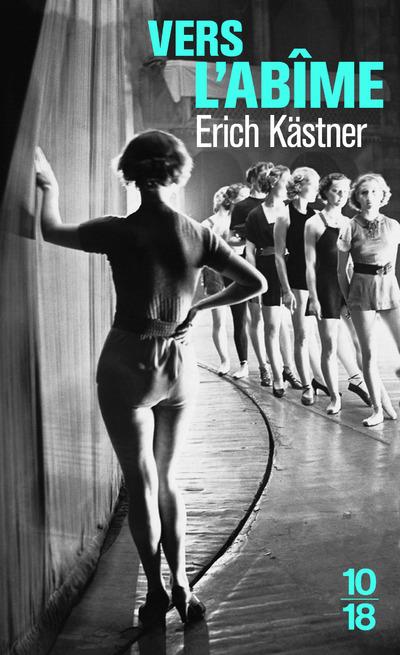Si on veut lire un roman assez fabuleux sur Kiev, il faut se précipiter sur « La Garde blanche », de Boulgakov.
Ce roman autobiographique, puissant, inspiré, a été rédigé entre 1922 et 1924. L’auteur a déclaré que c’est la mort de sa mère qui a déclenché un flot immense de souvenirs de sa jeunesse à Kiev pendant la guerre d’indépendance. Le roman s’ouvre d’ailleurs sur cette mort qui prend un côté symbolique comme si une partie de la Sainte Russie mourait avec cette femme. Au centre de l’intrigue, la famille Tourbine, turbulente, exotique, chaleureuse, avec pas mal d’embrouilles, de maldonne, d’élans héroïques et sentimentaux. Cette tribu vit dans la Maison Tourbine à plusieurs étages.

Il y a le personnage principal Nikolka. Son frère, Alexis, 27 ans, est médecin comme Boulgakov, il sera grièvement blessé pendant les combats de rue dans Kiev, secouru par la mystérieuse Julia. Et puis il y a leur sœur, Hélène, que son mari a abandonné en fuyant avec les Allemands. En 1917 les deux frères qui vivaient jusque-là sans soucis, entre livres, piano, jeunesse insouciante, turbulente, chahuteuse, sont entrainés dans la tourmente révolutionnaire et l’arrivée des Rouges, ils se sentent obligés de s’engager auprès de l’Armée blanche.
Tout au long du roman, jusqu’en fin 1919, la ville de Kiev est ballottée d’un camp à l’autre entre patriotes ukrainiens, socialistes modérés, partisans des rouges, ou en face hussards et cosaques du Don de cette « Garde Blanche » restée fidèle au Tsar . Ce ne sont qu’assauts des Rouges, contre-attaque des Blancs, fusillades dans les quartiers pris, perdus, repris, canonnades, re-attaques, escarmouches, corps à corps dans la neige, ou en pleine explosion fleurie du printemps. Boulgakov est précis pour montrer les forces en présence dans ces combats, avec détachements serbes, junkers allemands, uhlans, paysans mercenaires, engagements des lycéens. La vérité de la vie absurde éclate alors, ce qui se dérègle et s’affole dans la tête de ses jeunes personnages, le tout sur fonds d’inquiétude mystique.
Ne nous le cachons pas, le roman est complexe. Mais il séduit, vital, coloré, puissant, giboyeux d’images cristallines. Le lecteur est pris dans un élan et des scènes surprenantes, dynamiques, parfois teintées de surréalisme puisque des objets parlent, surtout les pendules.

Boulgakov s’autorise tout : monologues intérieurs des personnages, travellings dans des quartiers de la ville, détails fantastiques, vulgarités militaires, dialogues cocasses, méditations religieuses sur les hommes emportés dans le tourbillon du néant. Kiev devient une ville rêvée, une Cité Céleste, électrique et ensauvagée, une Ville trépidante qui frappe par la folie sensuelle avec laquelle l’auteur la décrit rue par rue, avec ses chutes de neige, son soleil soudain, ses jeunes morts, ses nuits de silence et ce sentiment d’anxiété qui soudain saisit le soir les habitants ou refugiés. Tout un brouillard de rêves et de cauchemars enveloppe le texte. Descriptions de quartier scintillantes et superbes. Le trivial et le bouffon se mêlent. Sans cesse, Boulgakov change de rythme, de tons, jouant de plusieurs niveaux chronologiques avec une prose percutante, enjouée, stridente, et des citations de chansons, des réminiscences littéraires, des allusions historiques. Habileté et dynamisme transfigurent beaucoup de scènes d’action, mais également, souvenirs d’enfance auréolés de nostalgie pour une vie famille qui est en train de se perdre, comme si maladies et souffrances détérioraient inéluctablement la maisonnée Tourbine, avec leurs chamailleries, leurs vieux piano, leurs bibliothèques. Des bouffées de tendresse, des zones soudaines de mélancolies nous rappellent Tchekhov, cependant quelque chose étincelle, brille, comme ces sabres et armes qu’on astique en vue du combat.
Il y a bien sûr des réminiscences tolstoïennes de « Guerre et Paix », pour décrire les réfugiés russes riches qui fuient Moscou soumise aux Bolcheviks et qui rêvent d’un avenir radieux en gagnant l’ouest, l’Allemagne, puis Paris.
Mais le cœur du livre reste la Maison Tourbine (devenue Musée aujourd’hui à Kiev) , avec ses locataires, son clair-obscur fastueux, ses pièces chaleureuses à tentures, ses lourds abat-jours, ses bronzes ,sa librairie, ses recoins à moisissures, ses cachettes, ses fenêtres qui donnent sur les toits voisins et l’infini trou muet du ciel. Cette maison devient un personnage fantastique particulièrement émouvant, une Cerisaie menacée de disparition, un grenier merveilleux, le réceptacle des souvenirs précieux, des jours enfuis, des visages familiers, alors qu’une immense marée de barbarie vient battre contre ses murs .
Le roman s’achève en citant des versets de l’Apocalypse. La morale de l’histoire à laquelle tout conduit est résumée dans les dernières lignes : « Tout passera. Les souffrances, les tourments, le sang, la faim, la peste. Le glaive disparaîtra, et seules les étoiles demeureront, quand il n’y aura plus trace sur la terre de nos corps et de nos efforts. Il n’est personne au monde qui ne sache cela. Alors pourquoi ne voulons-nous pas tourner nos regards vers elles ? «

Vraiment je vous invite à découvrir ce roman tourbillon, vertigineux, chaleureux, inspiré. Je vous conseille aussi de le lire dans l’édition Pléiade très compète car ses notes et commentaires permettent de comprendre les épisodes compliqués de la guerre civile entre 1917 et 1919 et ce que fut la « Rada «, mouvement qui regroupa des patriotes représentants du parti socialiste ukrainien et aussi ce que fut l’intermède de l’administration allemande qui dispersa la « Rada » à laquelle elle reprocha son nationalisme et son socialisme.

Extrait:
« Et voici qu’en cet hiver 1918 la Ville vivait d’une vie étrange, artificielle, très vraisemblablement destinée à rester unique dans les annales du XX° siècle. Derrière les murs de pierre, tous les appartements étaient surpeuplés. Les anciens habitants se serraient toujours davantage pour faire, bon gré, mal gré, de la place aux nouveaux venus qui déferlaient sur la Ville. Ceux-ci arrivaient précisément par le pont aux allures de flèche, ils venaient des contrées où flottaient de mystérieuses brumes bleutées.
On voyait fuir des banquiers aux tempes grises avec leurs femmes, fuir des hommes d’affaires de talent qui avaient laissé une procuration à leurs collaborateurs de Moscou ainsi que l’ordre de garder le contact avec ce nouveau monde en train de naître dans le royaume moscovite, on voyait fuir les propriétaires ayant abandonné leurs immeubles aux soins de commis occultes et sûr, fuir des industriels, des marchands, des avocats, des hommes publics. Fuir des journalistes de Moscou et de Saint-Pétersbourg créatures avides, véreuses et lâches. Des cocottes. Des dames honnêtes portant des noms de l’aristocratie. (..)
La Ville enflait, s’élargissait, débordait comme une pâte qui lève. Jusqu’à l’aube, on entendait le bruissement des maisons de jeu fréquentées par des personnalités pétersbourgeoises et locales ainsi que par des lieutenants et des major allemands à l’air fiers et importants, que les Russes craignaient et respectaient. (..)
Tout l’été 1918, la rue Nikolaïevskaïa fut allègrement sillonnée de fiacres gonflés de leur importance dans leurs caftans ouatinés et les rangées d’ampoules coniques de leurs voitures flamboyaient jusqu’à l’aube. Les vitrines des magasins n’étaient qu’une épaisse jungle de fleurs, les esturgeons pendaient telles des poutres de graisse dorée, aigles et médailles étincelaient d’un sombre éclat sur les bouteilles de merveilleux champagne.
Et tout l’été, tout l’été durant, les nouveaux venus ne cessèrent d’affluer encore et encore. »
Deuxième extrait:
« L’aîné des Tourbine est revenu dans sa ville natale juste après que le premier choc eut ébranlées collines qui dominent le Dniepr. Bon, se disait-il, cela va bientôt s’arrêter, et alors commencera cette vie qui est décrite dans les livres à l’odeur chocolat , or, non seulement elle ne commence pas, mais tout alentour devient de plus en plus terrible. Au nord, la tourmente de neige tourbillonne et hurle, et ici, on sent le sol trembler et gronder sourdement : la terre, inquiète, gémit de toutes ses entrailles. L’année 1918 touche à sa fin, et chaque jour qui vient se hérisse de menaces.

Pendant vingt ans de suite, un homme accomplit une tâche quelconque – par exemple, enseigner le droit romain -, et la vingt-et-unième année, il s’aperçoit soudain qu’il n’a que faire du droit romain, qu’il n’y a même jamais rien compris et qu’il n’aime pas ça, et qu’en réalité, il est un fin jardinier et brûle d’amour pour les fleurs. Cela vient, probablement, de l’imperfection de notre organisation sociale, qui fait que bien souvent, c’est souvent vers la fin de leur vie que les gens trouvent leur véritable place. »