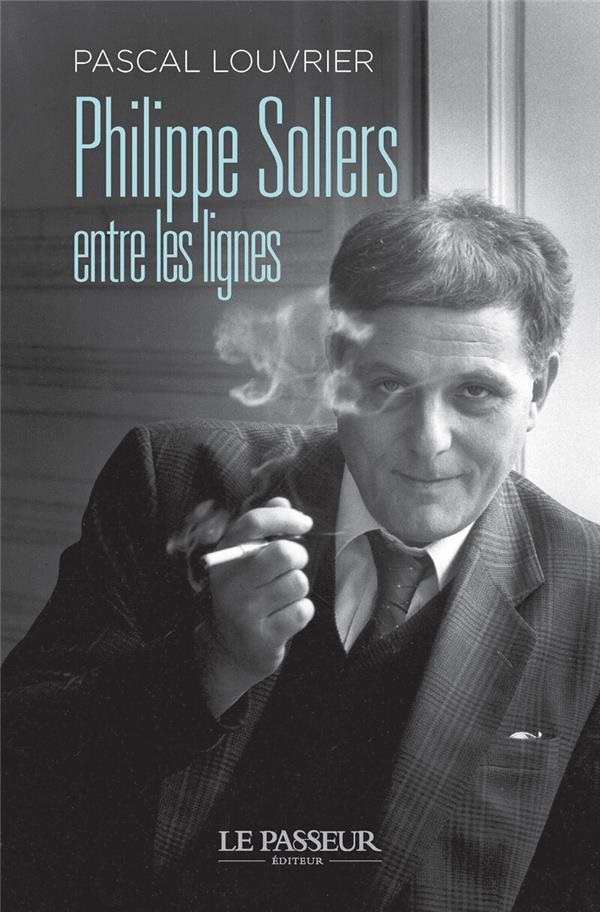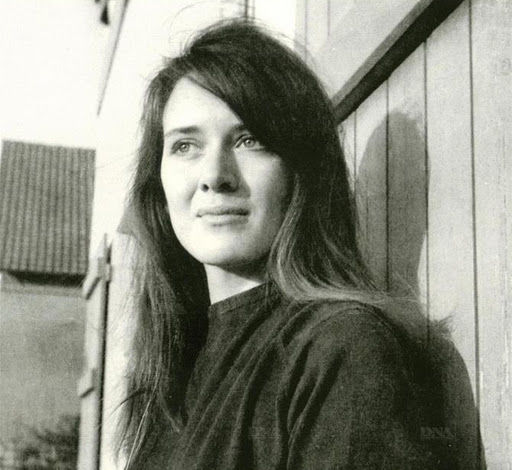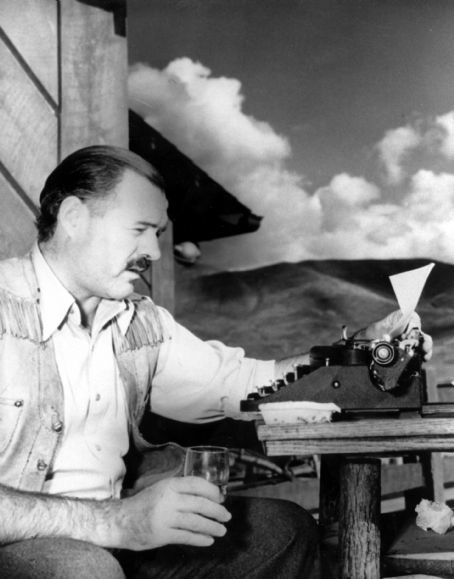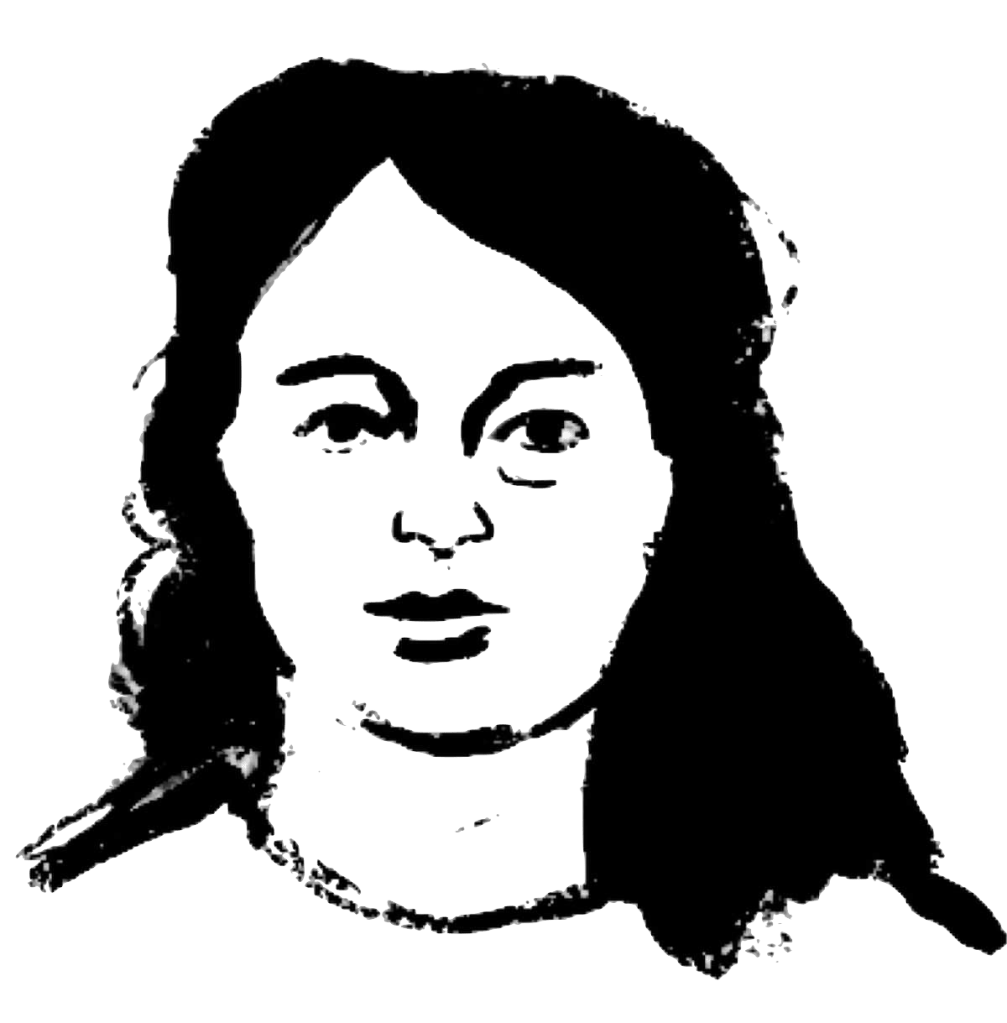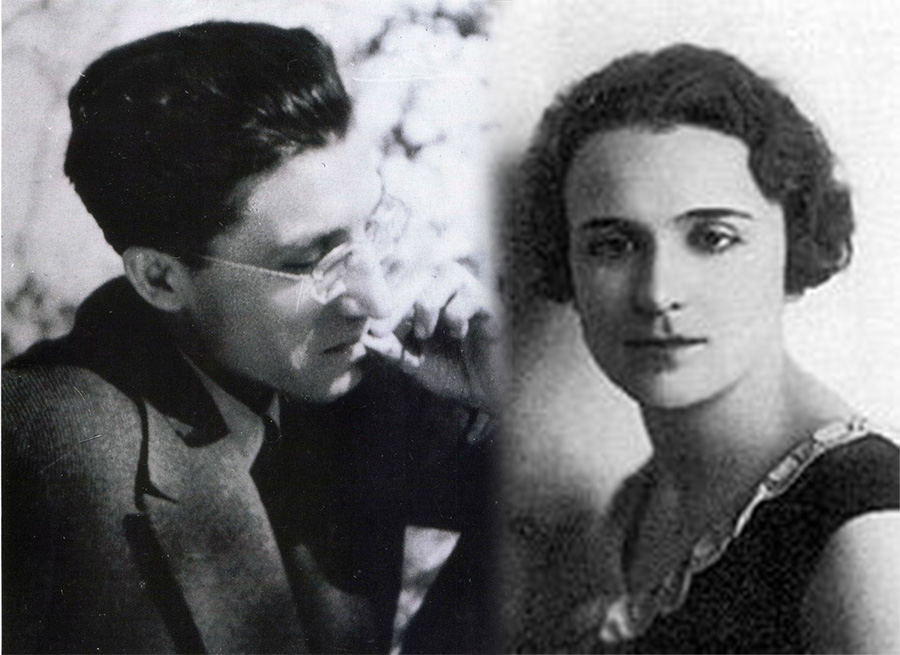J’ai passé quelques jours d’hiver à Venise,il y a 6 ans avec le livre de poche « La mort à Venise » de Thomas Mann . Journées d’hiver et de brume : quais à la lumière rasante , matinées ouateuses et brouillées, tombées de nuit brutales qui transforment les étroits canaux en coupe gorge, aux lumières incertaines ; on avance dans un labyrinthe inquiétant, envahi d’eau presque immobile aux remous gras et funèbres comme si une inondation insidieuse était en train de s ‘étendre entre palais, courettes, hospices, cloitres, casa ceci casa cela, ou demeures vides aux ornements gothiques en train de se délabrer. Toutes ces lentes ondulations noires en train de clapoter le long de portails de bois en train de moisir font penser à une agonie architecturale au ralenti.
J’étais surpris de l’extraordinaire acuité de thomas Mann pour capter ce caractère funèbre de la ville, comme si la thématique de sa nouvelle « la mort à Venise » émanait du décor, car dés qu’on quitte le grand canal et sa circulation incessante, ce sont remous gras, maisons aux volets clos avec un air d’abandon,, palais déserts, fenêtres vides, ambiance couvée. On suit des ondulations douceâtres qui viennent léchouiller des escaliers de pierre érodés, portails vermoulus protégés par de lourdes grilles de prison, et cette mouillure perpétuelle charriant des pourrissements, ces franges d’écume le long d’embarcations bâchées avec des toiles aux auréoles jaunes pisse, tout ça laisse une impression de fermentation malsaine , domaine de lourds secrets, avec l’odeur rance que soulève soudain une barque à moteur.
La nouvelle de Mann s’inscrit admirablement cet enchantement pourrissant, car nous sommes pris dans une ambiance de lente putréfaction. Cela est d’autant plus évident que le texte explore le naufrage, la décrépitude physique, de l’écrivain célèbre -et las- Gustav Aschenbach. Il est seul, prisonnier de l’appellation « grand écrivain officiel « qu’on étudie en classe dans toute l’ Allemagne, manière d’être coincé dans le sarcophage de la culture officielle. Et si on parcourt toute la correspondance de thomas Mann on remarque que Mann éprouve sentiment d’être embaumé de son vivant dans célébrité , enseveli sous les hommages et les récompenses.
La rencontre avec le bel adolescent polonais Tadzio, sorte d’archange blond entouré et gardé par sa famille polonaise pépiante, va secouer, happer, bouleverser notre écrivain .on a tout dit de ce chavirement d’un écrivain si bourgeois qui découvre, le trouble, l’obsession de la Beauté et de la jeunesse, ce qui ébranle tout son psychisme. Aschenbach prend conscience que son œuvre, si bourgeoise, n’a pas pris en compte l’Eros, les rafales du Désir sexuel. Il ne maitrise plus sa libido.

Je n’avais pas bien compris dans mes précédentes lectures combien il y a un parallélisme étonnant entre la décomposition morale d’une ville qui cache son épidémie et ment aux touristes pour continuer à faire marcher le tiroir- caisse et la décomposition accélérée des certitudes d’un écrivain bourgeois devenu l’esclave de ses sens face au jeune blond Tadzio .
Aschenbach découvre que sa dignité sociale s’effondre. Au cholera qui circule dans Venise , répond exactement la fièvre sexuelle qui s’empare d’Aschenbach . Au marécage d’une ville, cette serre chaude pleine de germes mortels répond le marécage libidinal dans lequel s’enfonce Aschenbach . Au secret honteux d’une ville répond le secret de l’écrivain qui découvre son homosexualité.
Ces deux thèmes sont magnifiquement entrelacés par thomas Mann. Et l’ironie des phrases, ce talent si élaboré de Mann ajoute un glacis, une élégance, une précision détachée au récit de la connaissance de soi.. La tragédie d’Aschenbach, grand bourgeois pris dans la tempête des sens, se joue dans une prose à reflets aquatiques sombres , ce qu’il a appelé « « l’aristocratique morbidité de la littérature » dans une autre nouvelle « Tonio Kröger » rédigée en 1903, donc neuf ans avant « La mort à Venise » .Dans ces deux textes il puise aux mêmes sources d’un érotisme pédophile qu’il vit comme une infernale culpabilité.
De plus, tout au long de son voyage de Munich à Venise, l’itinéraire est marqué par des rencontres de personnages (ça fait penser à un jeu d’échecs) qui annoncent la présence Mort : à savoir 1)le promeneur du cimetière de Munich, 2)le gondolier muet, sorte de Charon avec sa barque qui mène l’écrivain au pays des morts, 3)la troupe de musiciens italiens grimaçants, ricanant, railleurs, qui jouent et accompagnent les hontes d’Aschenbach de contorsions douteuses devant ce parterre de grands bourgeois mondains, parfumés, proustiens, à la terrasse du Grand Hôtel.

La vraie nature érotique du « bourgeois » Aschenbach-si bien dissimulée dans le mensonge de son œuvre académique- est révélée dans un rêve ;c’est une orgie qui semble sortie du « Salammbô, » de Flaubert, orgie que Thomas Mann appelle joliment « les privilèges du chaos »). A la découverte de sa vraie nature sexuelle s’ajoute la découverte de sa décrépitude. Il voit dans le regard des autres qu’il n’est qu’un vieillard libidineux, un « vieux beau » décrépit et fardé. Et l’objet de son désir, Tadzio, se moque de ce vieillard qui le suit comme un chien dans le dédale des ruelles de Venise. L’adolescent savoure son ascendant sur le vieil homme. Lorsqu’Aschenbach est mis au courant de l’épidémie cachée ( ô ironie par un employé anglais d’une agence et non pas par un italien),il a un premier geste de charité pour alerter les autres, mais se ravise et dans un retournement faustien, brutal, Aschenbach prend la résolution bien plus excitante et cruelle de se taire. Il jouit de ne pas avertir la famille de Tadzio de la maladie qui s’étend sur la lagune et les menace. Comme si l’homme profond, voulait exercer sa nature criminelle et devenir une figure du Mal ou son zélé collaborateur. Le docteur Faustus est déjà là. Le vieillard » désirant « ne veut pas lâcher sa jeune proie. Mann a réussit là un pacte faustien parfait. Il se venge de son Désir en choisissant d être du côté de La Mort.

La part cachée, tyrannique, érotique, dionysiaque, avide, sournoise ,féroce, de l’écrivain atteint là un sommet de perversité : j’entraine tout le monde dans la Mort ce qui me donne l’illusion d’en être le maitre. Point ultime de sa part maudite . L’érotisme, soudain, libère en lui une pulsion de mort, mais également l’affranchit de toute limite morale qui corsetait l’écrivain officiel adulé.. Il récupère une souveraineté dans la transgression. Et son angoisse, sa culpabilité si tourmentante, si humiliante se transforme un ouverture maléfique., en affranchissement. C’est son joker.
Les visites chez le barbier de l’hôtel pour se faire teindre les cheveux et mettre du rouge aux joues pour mimer une jeunesse perdue, et masquer sa déchéance physique ont sans doute eu pour conséquence de métamorphoser sa rancœur en en jubilation :imaginer la mort des autres ..
Enfin, thomas Mann cultive la métaphore d’une ville qui s’enfonce dans la vase, pour nous révéler sa vraie nature d’écrivain. Il pose clairement une équivalence entre sources libidinales cachées et source d’énergie pour écrire. Dans certaines lettres et confidences à ses proches, il n’a jamais caché le « fumier » ou le « compost », sur lequel fleurit une œuvre.
Il écrit tranquillement : « laisser le style suivre les lignes du corps ».c’est déjà tout le programme que va développer « la montagne magique », qu’il commencera à écrire un an plus tard.. car il y a non seulement la fascination pour corps parfait, en pleine éclat(Tadzio) mais fascination encore plus forte pour le corps malade. il faut savoir que toute sa vie Thomas Mann a souffert de migraines, de nausées, de fièvres, de coups de fatigue ,d’insomnies, de vertiges, de mauvaise digestion, de malaises soudains. .Ses lettres, ses journaux forment la grande litanie d’un homme qui ne cesse de somatiser. Et de consulter des médecins.

Le récit-parabole de « la mort à venise » annonce la « maladie » et les pathologies d’un Occident tout entier malade(nous sommes en 1912, n’oublions pas…) Mann, déjà marqué par le Nietzsche dionysiaque, et le pessimisme de Schopenhauer devait lire deux ans plus tard le livre de Spengler « déclin de l’Occident » dont il a dit : »c’est un essai qui rejoint tout ce que je pensais déjà, une des lectures capitales de ma vie ! » .