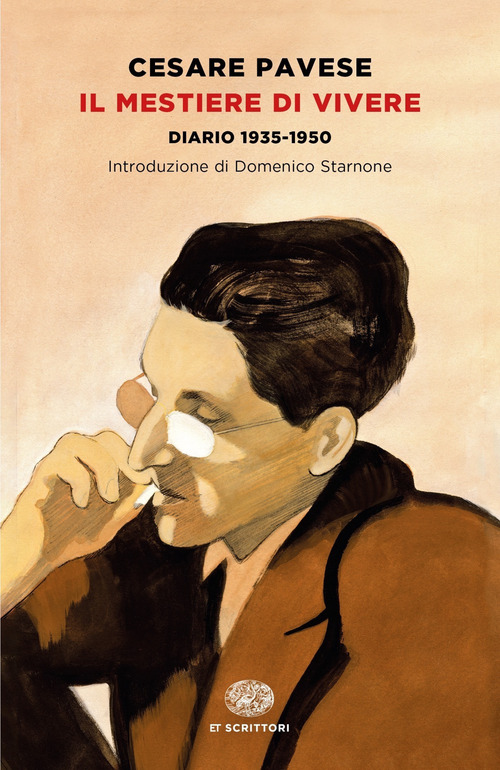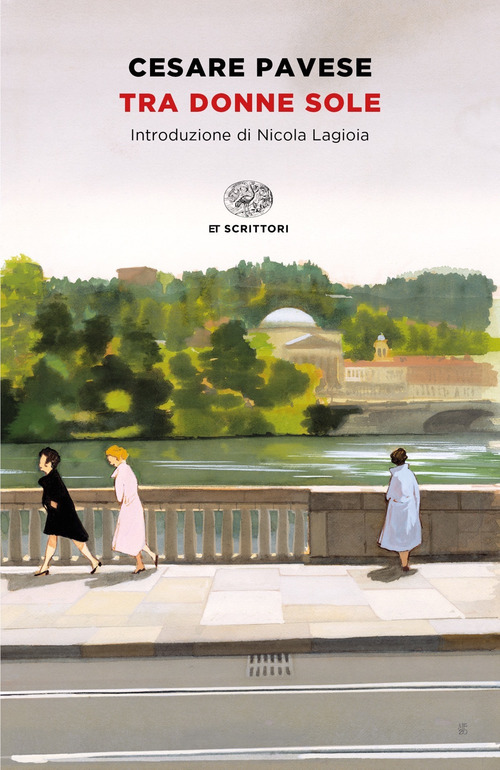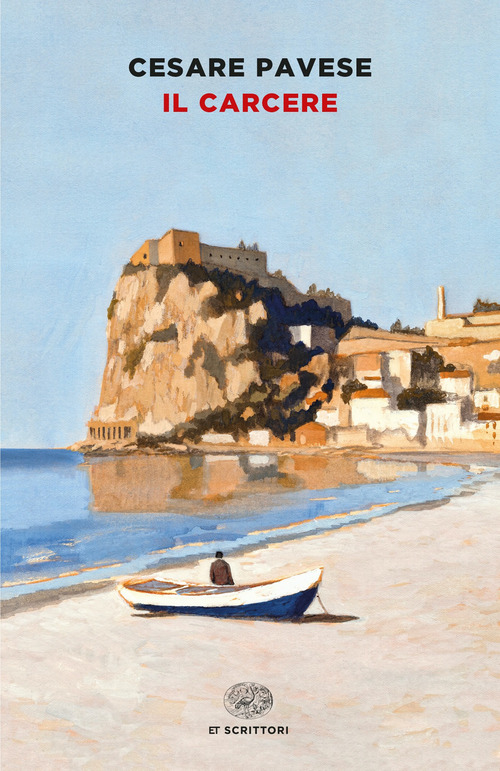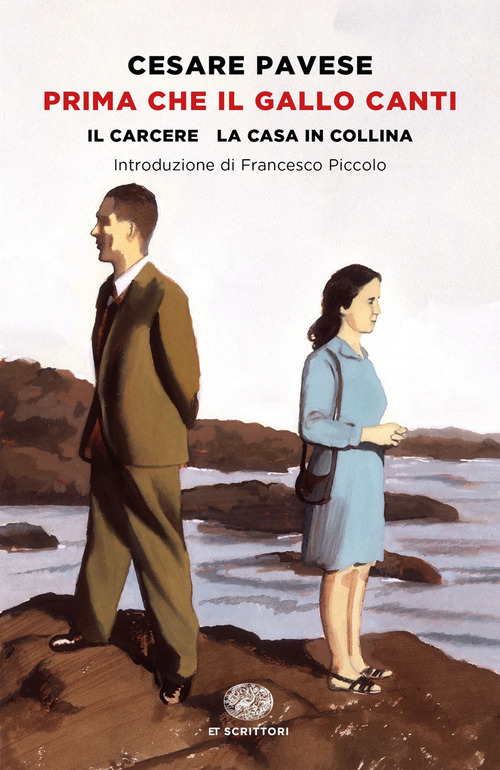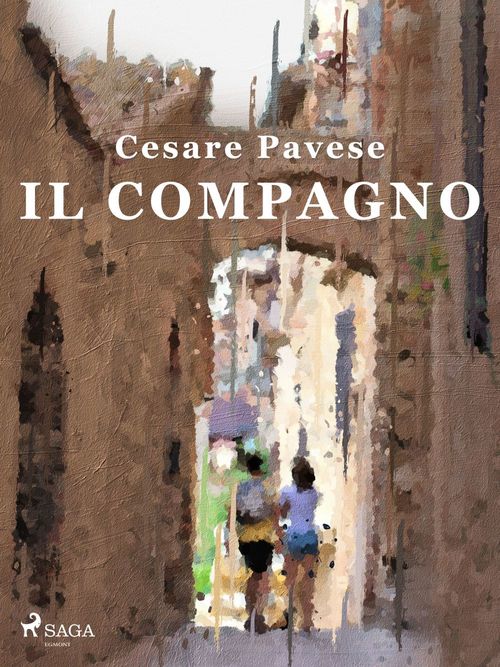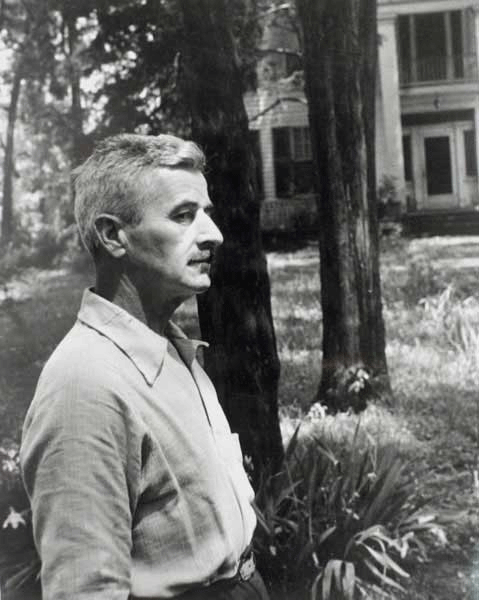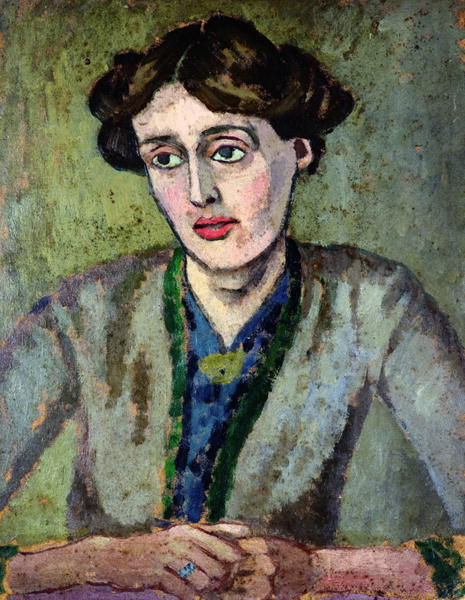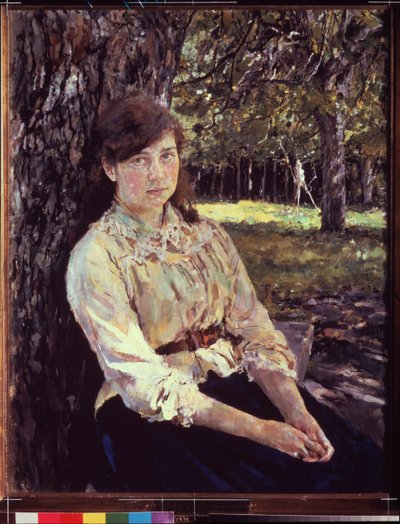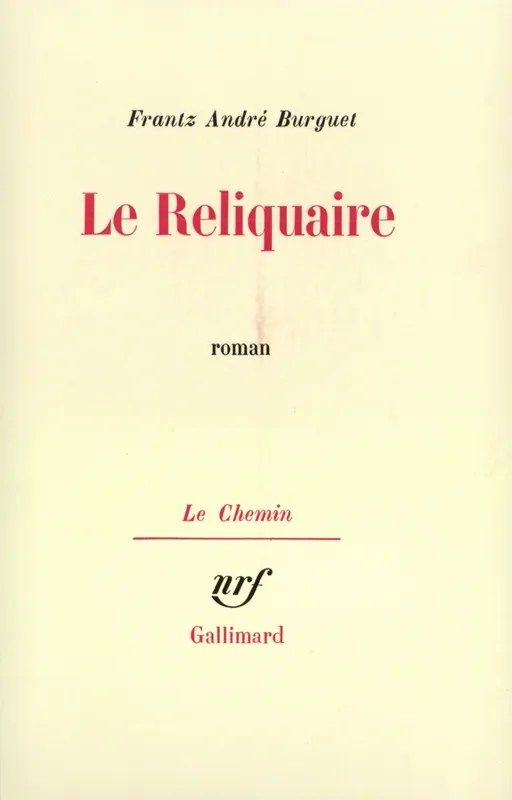J’avais lu il y a plus de quarante ans ce « Journal d’un curé » de campagne »,puis relu , avec, à chaque fois un attachement différent et remarquant des passages n des personnages, des scènes, et des registres différents.Mais toujours sidéré par la proximité de ce jeune curé malade avec tout lecteur croyant ou non. Ce sont ses difficultés, son impuissance, qui le rendent si attachant car il éprouve de la difficulté à prier, se sent mal à l’aise dans sa paroisse, dépassé par sa mission pastorale trop lourde pour lui ,et son immaturité. Bernanos lui-même avait souvent déclaré que c’était son texte préféré.

Aujourd’hui, texte relu, je reste sidéré par ce mélange de grâce, d’angoisse et de soudaine et simple odeur de la terre et de la pluie. N’étant pas un catholique je me dis que je ne suis pas le lecteur idéal , notamment pour apprécier les emprunts aux évangiles de Saint-Matthieu, aux textes de Thérèse de Lisieux pou saisir les enjeux dans le développement d’une théologie, notamment sur la place des saints, ou ce que représente l’obéissance à la hiérarchie de l’Église de son temps à laquelle le curé d’Ambricourt tient tant malgré ses révoltes et ses moments de trou noir.
Ce qui m’a le plus intéressé c’est que, depuis les bistrots de Majorque, en 1935, où il écrit ce texte ,Bernanos restitue magnifiquement le boulonnais, les plaines d’Artois,l’école du village, les cafés à odeur de genièvre, les nuits de grand vent et de grand désespoir, et bien sûr, ce qui émane de charité sur un visage, au moment le plus inattendu. .
Avant de parler directement du texte, je voudrais citer cet extrait des « Grands cimetières sous la lune » qui éclaire des pans entiers de l’œuvre de Bernanos en évoquant cette source inépuisable, son enfance. : »Qu’importe ma vie ! Je veux seulement qu’elle reste jusqu’au bout fidèle à l’enfant que je fus . Oui, ce que j’ai d’honneur et ce peu de courage, je le tiens de l’être aujourd’hui pour moi mystérieux qui trottait sous la pluie de septembre, à travers les pâturages ruisselants d’eau, le cœur plein de la rentrée prochaine, des préaux funèbres où l’accueillerait bientôt le noir hiver , des classes puantes, des réfectoires à la grasse haleine, des interminables grand’messes à fanfares où une petite âme harassée ne saurait rien partager avec Dieu que l’ennui- de l’enfant que je fus et qui est pour moi à présent pour moi comme un aïeul. »
Paysages sombres, mouillés, venteux, vallons encaissés, chemins détrempés , villages fouettés et hostiles , chaque habitant est planqué derrière ses rideaux , chaque être ratatiné sur ses misérables secrets mais guette et juge ce trop jeune curé. . Tout se passe comme si les villageois ressemblaient à du bétail errant, comme si un sommeil de la raison et de la foi avait saisi une paroisse ; des cœurs endurcis traversent en somnambules leur humble voyage éphémère entre l’arche ciel et terre. Bien les routes traversent des labours nus dans ce « Journal » si intime (mais aussi si anonyme et si loin des petites singularités étriquées de l’autofiction) qu’il nous entraîne presque à notre insu dans une aventure dont on sent qu’elle porte quelque chose de surnaturel dans son incandescence.
Les fonds de vallée cachent des cabanes pour braconniers, qui font aussi penser que ce jeune curé, lui aussi, sorti de son presbytère part en chasse. A sa manière il braconne les âmes . Il cherche les plus humbles et traque les plus orgueilleux, dans une sorte de ronde de nuit -sa nuit- pour les amener à Dieu, à mains nues .

Bernanos ,à partir de cette terre lourde, grasse, d’Artois,qui semble engluer les villageois dans l’indifférence,l’égoïsme, le repli, joue admirablement de cette lumière d’angoisse qui éclaire comme une aube d’hiver la paroisse « morte » que le curé d’Ambricourt est censé faire revivre. Et même si souvent l’odeur de terre du vieux pays passe entre les fentes du texte, avec une tendresse si nostalgique,il n’en reste pas moins que le roman laboure une terre d’angoisse sans cesse retournée.
Ces angoisses furent –la correspondance en témoigne- celles de Bernanos lui-même. Un certain accent de vérité ne trompe pas. Ce curé, perdu dans la blancheur de ses nuits d’insomnie , de doute, comme l’auteur, attend toujours l’aube comme une délivrance. .
Cela rend le personnage d’autant plus humain et proche du lecteur que dans bien des pages apparaît une charité vraie, une curiosité passionnée , mêlées à un courage recommencé, qui ressemble à un courage christique pour lutter contre cette double solitude : celle d’un village qui se déchristianise, et celle d’une foi qui connaît de sérieuses éclipses.

Ce qui frappe aussi c’est que, dans le dénuement d’une mission pastorale si ingrate, si difficile, dans ce village(modèle réduit d’une grande partie du monde?) le frémissement de la sensibilité n’exclut jamais la joie et l’espérance. Rappelons ce qu’écrivait Bernanos le 13 juillet 1942 à son ami Raul Fernandes : « Ah!j’ignore si la vie m’aime,mais le bon Dieu m’a fait la grâce de bien aimer la vie ,la vie que les imbéciles parcourent à toute vitesse sans prendre le temps de la regarder, la vie pleine de secrets admirables qu’elle met à la disposition de tous, et que personne ne lui demande jamais. »
Il est aussi frappant de voir à quel point ce curé d’Ambricourt –guidé par le curé de Torcy inébranlable, exemplaire- fait de la pauvreté une véritable mystique : »Lorsqu’on a connu la misère, ses mystérieuses et incommunicables joies,-les écrivains russe, par exemple, vous font pleurer. » Rappelons que Dostoïevski n’est jamais loin chez Bernanos.
Plus loin le brave et solide curé Torcy lui répète « Notre seigneur en épousant la pauvreté a tellement élevé le pauvre en dignité, qu’on ne le fera plus descendre de son piédestal(..) on l’aime encore mieux révolté que résigné, il semble déjà appartenir au royaume de Dieu, où les premiers seront les derniers(..) »
Ceux qui ont connu ou correspondu avec Bernanos disent que c’est le curé de Torcy , impénétrable sous sa rondeur bourrue, mais avec des éclairs de tendresse face au jeune prêtre anxieux, qui exprime au plus près les positions du catholique Bernanos toujours dressé contre les « marchands de phrases » et les « bricoleurs de révolution »,et les prêtres mondains qui ont oublié les pauvres pour s’asseoir à la table des riches ou qui parfument leurs discours d’un humanisme mou.. le mot de Torcy qui le résume est « faire face » et précise : » « Ça pleurniche au lieu de commander. »
De tous les personnages de ce « journal d’un curé de campagne » ce sont les jeunes femmes les plus intéressantes.et ce petit curé d’ambricourt manifeste une lucidité particulière pour sonder l’état intérieur des âmes, et malgré de multiples maladresses (notamment sa brutalité vis à vis de la Comtesse) ,malgré sa timidité ,sa gaucherie, son inexpérience, et des tourments si violemment oppressants,il possède une pénétration soudaine. La grande scène de la Comtesse, point culminant du texte , lui permet de comprendre combien cette femme s’est enfermée et paralysée elle même depuis la mort de son enfant. Et il l’a délivre ,dans une espèce d’ accouchement violent..

Le cas de Mademoiselle Chantal, la révoltée, est étonnant. La fille du comte et de la comtesse, les châtelains d’Ambricourt, voue une haine absolue à sa mère et son père pour sa liaison avec l’institutrice. Chantal débite des folies, « sans lever la voix »,dit le journal ,mais dans un moment absolument miraculeux, le petit curé arrive à faire entrer « Mademoiselle Chantal » dans le confessionnal ; il se passe alors une brève rencontre capitale , une complicité,inattendue, comme si l’orgueil blessé de la jeune fille rencontrait et se joignait à l’orgueil blessé de son confesseur. « A ce moment , il s’est passé une chose singulière. Je ne l’explique pas, je la rapporte telle qu’elle. Je suis si fatigué, si nerveux, qu’il est bien possible, après tout, que j’aie rêvé. Bref, tandis que je fixais ce trou d’ombres où , même en pleine jour il m’est difficile de reconnaître un visage, celui de Melle Chantal a commencé d’apparaître peu à, peu, par degrés. L’image se tenait là, sous mes yeux, dans une sorte d’instabilité merveilleuse, et je restais immobile comme si la moindre geste eût dû l’effacer. »
« Que voulez vous ? À partir d’un certain moment je n’invente rien, je raconte ce que je vois. Des êtres que j’ai aimés passent sur l’écran, et je ne les reconnais que longtemps après, quand ils ont cessé d’agir et de parler.. » écrit-il de Palma de Majorque en janvier 1936.
Il y a également la féminité hardie de la petite Séraphita Dumouchel( pas loin de Mouchette..) qui défie de sa jeune coquetterie le jeune prêtre ; et c’est elle dans la plus belle scène –à mon sens- du livre, qui essuie le visage du prêtre, égaré en plein champ , terrassé par la douleur de son cancer à l’estomac et qui vomit du sang sur sa soutane .Seraphita, figure trouble qui retrouve le geste biblique de cette Véronique essuyant le visage du Christ.
A propos de Séraphita, le jeune prêtre expédie un peu vite ce qu’il appelle le « problème de la luxure », mais ne cachant pas que c’est au cours du catéchisme, devant les visages des futures jeunes communiantes qu’il se sent troublé et démuni. Les scandales récents de pédophilie dans l’église catholique semblent lui donner raison.
A ceux qui ont déjà fréquenté Bernanos, on retrouvera son éloge des routes, de l‘aube, de la fausse sérénité des familles bourgeoises qui cache des turpitudes », ses combats contre les faux prêtres, plutôt ceux de la haute hiérarchie, et le goût de l‘enfance qu’il fait assumer par son prêtre maladroit , caché sous un comptoir de bistrot où viennent échouer les ivrognes de la région.
En revanche, suis resté perplexe devant ce journal qui résonne de tant d’ aveux de défaillance, de nuits affreuses » de prières vides de sens, de doutes multipliés , que l‘ensemble frôle un apitoiement . Que dire, aussi de ces rêveries autour d’un Moyen-âge qui ressemble à un livre d’images pieuses, avec cette « chevalerie chrétienne » qui oscille entre Saint-Louis sous son chêne et Jeanne au sacre de Reims ? Est-ce une nostalgie idéalisée d’ une monarchie ?

Enfin, une autre réussite du livre se trouve dans la délicatesse avec laquelle le village ,le pays, ses lumière plombées ou diaphanes jouent le rôle d’intercesseur entre les choses visibles et celles qui sont invisibles. Par exemple, dans une brèves conversation sur une place déserte du village, un vol de pigeons passe régulièrement autour des deux personnages. Ils entendent « siffler leurs ailes » et attendent le retour de ces oiseaux comme si un message de fin du monde était suggéré en filigrane par ces mots si simples : « ce sifflement pareil à celui d’une immense faux ».ou bien quand le curé découvre de sa fenêtre un monde devenu interrogation angoissée.. »Je viens de passer une grande heure à ma fenêtre, en dépit du froid.Le clair de lune fait dans la vallée une espèce d’ouate lumineuse si légère que le mouvement même de l’air l’effile en longues traînées qui montent obliquement dans le ciel, y semblent planer à une hauteur vertigineuse .Toutes proches pourtant.. Si proches que j’en vois flotter des lambeaux, à la cime des peupliers. Ô chimères ! Nous ne connaissons réellement rien de ce monde, nous ne sommes pas au monde. » Les plus belles interrogations muettes du prêtre , ses appels intimes, naissent ainsi de détails du paysage bernanosien. C’est un des miracles du récit.

C’est le critique Gaëtan Picon qui avait résumé cet art: »le surnaturel »est pour cette œuvre ce que le destin, ou l’ histoire, ou la liberté sont pour d’autre :son lieu. C’est la lumière du surnaturel que nous pressentons derrière les ombres fuligineuses du drame terrestre, et qui leur donne une surprenante grandeur. »