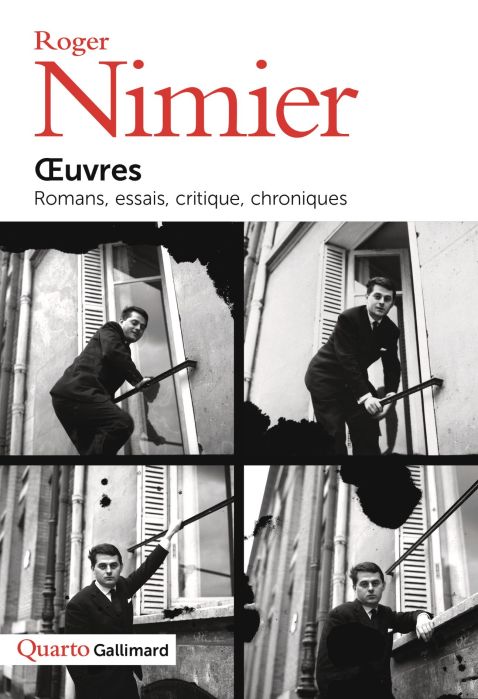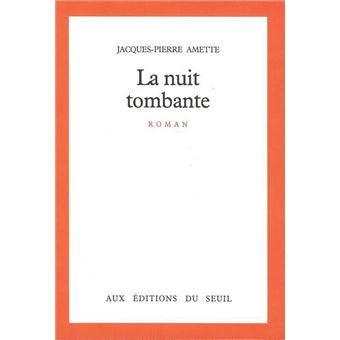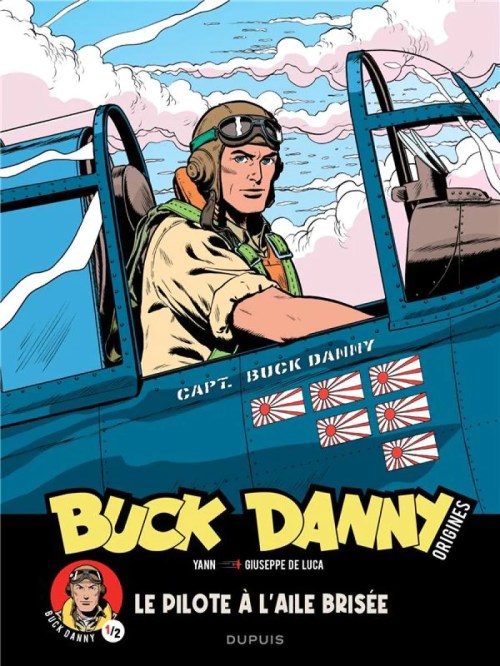Chaque jour, avant huit heures, je m’installe au bord de l’eau. J’aime cette heure, cette tranquillité le long de la baie, le ciel gris, le silence miroite, les villas aux volets fermés , le gargouillis de la marée qui monte . La baie et ses multiples criques devient un lagon de mercure. Je me réfugie ici pour fumer une première cigarette. Là où je m’installe il y a deux roches plates aux stratifications couleur de plomb qui affleurent au-dessus de la pente de sable. Derrière moi , la route quasi déserte n’est empruntée que par les camionnettes des ostréiculteurs. Enfin j’aime cet endroit pour son haut talus dunaire orné d’asters et de silènes, que le vent fait vibrer .
Il y a sept ans, chaque matin, j’attendais une belle baigneuse .
C’était une grande jeune femme d’environ trente ans. Elle apparaissait souvent un peu avant neuf heures sur l’unique route de la presqu’île, démarche souple et lascive dans un peignoir blanc . Elle venait de la grande villa faussement Renaissance qui surplombait le port, celle avec des tourelles , des pignons, des vitraux et un charmant auvent ardoisé.
Les gens du village racontent que dans les années 80 une bande « de hippies » avait envahi la villa et que ça sentait le hasch jusque sur le parking du port.

Quand je passais , il y a sept ans, devant chez cette villa « Roc Choquette » , par les fenêtres ouvertes j’ entendais l’Album Blanc des Beatles ou le lancinant Sunny Afternoon des Kinks. Bon choix Cette jeune femme était toujours seule,portait une longue robe flasque curieusement peinturlurée de mauve et de brun ,avec une échancrure pour laisser voir le creux bruni de son épaule gauche. Elle flânait dans le jardin, souvent avec un chapeau de paille immense ou lisait des bouquins anglais,installée de travers dans une chaise longue avec un lapin blanc logé dans le creux de ses jambes. Quand j’y repense j’ai l’impression de voir une de ces vieilles diapositives saturées de soleil et toute pâlies qu’in oublie dans une boite à chaussures. J Je fus souvent tenté de sortir mon petit compact Minolta pour la photographier tellement je la trouvais splendide. Je gagnais ma crique préférée en me répétant « jolis seins jolis seins vraiment » comme on se répète une comptine.C’est vrai qu’ il émanait d’elle quelque chose de libre, de nonchalant, de sexy, de coquin dans sa démarche et ses moindres gestes, quelque chose que je n’ai jamais retrouvé chez aucune autre femme.
Elle ressemblait à l’actrice suédoise Bibi Andersson: même petit nez court, même regard vif , scrutateur, quand elle me regardait , mais corrigé par une moue coquine avec une lèvre inférieure délicatement ourlée . C’était vraiment une copie de Bibi Andersson dans les deux films de Bergman que je préférais , Persona, et Les Fraises Sauvages . Donc elle ’étendait sa serviette de plage d’un blanc immaculé pas loin de moi, dix mètres à tout casser. Elle prenait soin d’elle avec des tas d’onguents , de crèmes, de tubes et de sticks;elle savourait l’air frais quelques minutes avant de plonger dans l’eau calme de la baie.
Je me souviens qu’elle aimait examiner son visage dans un miroir minuscule,comme pour vérifier l’étrangeté minérale de son front et de ses pommette ou l’arc parfait de ses sourcils . Puis elle quittait son peignoir pelucheux beige et avançait avec prudence vers les premières vagues, et enfin elle glissait sournoisement dans l’eau. Son éloignement et sa disparition complète dans la baie me surprenait toujours comme un moment désagréable qui me laissait démuni . L’absence. Je me répétais ce mot « absence » ,oui l’absence de cette nageuse me restait mystérieux . Les gens sont là, rient et plaisantent autour d’une table, ils bavardent,ils blaguent ,ils vous touchent l’épaule ou le bras, vous sortent de votre torpeur, et le temps que vous preniez un sucre dans le sucrier ils ne sont plus là. , disparus dans le petit escalier qui mène au port, on entend leurs rires qui s’éloignent. Sur la table subsiste le désordre du petit déjeuner, avec les tasses vides et poisseuses, le cendrier plein de mégots, une boite de cacao rouillée, le bocal de confitures d’orange qui attire une guêpe.Voilà ,il y avait encore un instant des bavardages, des cris d’enfants, des jeux de mots pathétiques et soudain , le silence, le monde vaste et désert de la presqu’île bourdonne , un mirage , le rien, les éclats de l’eau, l’arène vide,profonde et bleue du ciel. C’est un phénomène curieux, un peu insaisissable qui hante mes étés . Faire comme si c’était banal.
Pendant ce temps ma belle nageuse avait disparu vers le large. En l’attendant je craquais des allumettes, avec un bout soufré jaune ; elles s éteignaient dans les vaguelettes avec un minuscule chuintement.Pourquoi est- ce je faisais ça ? Je ne sais pas. C’était comme une offrande, une expiation, un vœu.
Je craignais que la nageuse ne revienne jamais et que la presqu’île se réduise à nouveau à un banal coin de terre brune venteux avec ses pentes rocheuses pelées et ingrates annonçant la mauvaise saison.
Quelques traînées de nuages se dissipaient, j’écoutais les discrets écroulement et chuintement du sable coulant sous mes pieds. La matinée était à l’abandon quelques vagues étincelaient. le Temps alors m’appartenait comme il n’a jamais appartenu à personne.
Deux ou trois jeunes sportifs passaient en courant sur la route et me saluaient
Je me demandais si Bibi Andersson était morte ou si elle vivait encore quelque part sur une île suédoise. Je l’avais croisée il y a plus de vingt ans sur un trottoir à Saint-germain des Prés. Elle courait d’une manière désordonnée pour rattraper un taxi et je l’avais trouvée stupéfiante de beauté.J’avais lu, plus tard, dans un magazine, qu’elle avait eu une période hasardeuse de sa vie à la recherche de n’importe quel partenaire.

Il était presque dix heures et demie , le ciel se partageait avec une zone plus limpide et plus froide , le temps changeait , des vaguelettes clapotaient plus proches de mes jambes ,les nuages vers le port formaient des amoncellements de neiges légendaires . J’aimais ces moments étonnants de silence, quand le vent tombe et que des grains de mica scintillent dans les fissures qui creusent le remblai. C’est comme si on pouvait deviner la vie secrète des couches géologiques, les Temps Anciens reviennent , quand la terre était déserte et peuplée de sauriens endormis. J’aimais aussi imaginer la vie secrète de ma nageuse. J’avais envie de connaître ce qui l’exaltait ou la tourmentait .J’imagine qu’avec une telle beauté , une telle attraction érotique , sa jeunesse avait dû être un tourbillon radieux de soupirants intimidés , tout ceci avait dû embellir son adolescence et rendre fastueuse son entrée dans la vie adulte .Quel effet cela avait-il eu sur son caractère ? Est-ce que ça avait fouetté son appétit de vivre et donné une frénétique envie jouir des corps des hommes et des femmes ? Avait-elle éprouvé une certaine culpabilité en faisant naître autant de désirs ? Gardait-elle d’ obsédants souvenirs ,certains obscènes ? Je ne sais pourquoi, mais je l’imaginais en étudiante sérieuse gagnant les Beaux Arts, chemisier beige et jupe droite caramel , élève réservée, hyper sérieuse, serrant son carton à dessin dans les couloirs . Je la voyais assise sur un tabouret, face à un Hercule de plâtre choisissant un fusain avec minutie. Je la voyais concentrée sur les tuniques plissées d’Hélène de Troie ou de Cérès.
Un matin du début juillet, elle sortit de l’eau , courut s’enrouler dans son peignoir et me fixa avec une moue ironique qui devenait gênante.
-Vous habitez dans le coin ?
Je répondis bêtement :
-Oui. La petite maison de pêcheur, tout au bout.
-Moi j’habite la maison blanche avec les volets bleu pâle.
– Je sais. La Villa Renaissance.
Elle brossa ses cheveux et remit un peu de rouge sur ses lèvres.
– Je pars dimanche.
– Demain ?
-Hmm.. Demain matin.

Elle fouilla dans son sac et sortit une paire de lunettes d’un bizarre galbe ovale, des verres bombés vert étang qui ressemblaient à des yeux d’insecte . Elle souffla sur les branches .
-Vous êtes arrivée en Juin ?
– Oui. Mon deuxième été. Je suis venue deux étés.
Il y eut un long silence. Elle enfonçait ses doigts dans ses cheveux ébouriffés.
Puis :
– La Bretagne, c’est fini. Je retourne à Bruxelles.
-Ah..
-Déroute financière . Mon mari. Déroute conjugale. Fin de partie.
Elle fouilla tranquillement dans son sac et en sortit un sachet avec des cacahuètes dont elle déchira la cellophane.
Elle me le tendis :
-Non merci.
L’horizon étincelant de la baie était devenu un ennemi. Je hasardai :
-La première fois que je suis venu,ici c’était un chemin de terre.
-Vous veniez ici enfant ?
-Presque.
Je précisai :
-La première fois que je vous ai vue , une bande d’enfants jouait avec un tonneau de goudron laissé par les Ponts et Chaussées .
-Oui, je m’en souviens.
Nous restâmes sans rien dire, le sable coulait entre mes doigts. Je me souvenais de la chaleur étouffante du mois de Juin, quand elle était venue dans une Volvo argentée qui avait des traces de rouille.
-Vous portiez une robe étroite en maille large, marron, et des collants noirs.
– Quelle mémoire…

La baie prenait une lumière d’estuaire. Elle inclina la tete comme pour offrir son visage au soleil. Les ailes de son nez avaient légèrement pelé.
-Parlez moi de vous,dit-elle.
-Rien à dire
– Vraiment ?
-Je vends des châssis de fenêtres. Je suis ce qu’on appelle un cadre commercial.
Je dis :
-J’aime être ici.
-Je sais.
Elle ajouta :
-Je rentre à Bruxelles tôt demain.
Elle sortit un portable du sac, pianota dessus mais n’obtint pas de réseau.
-Mon mari est en train de couler son théâtre et de foutre en l’air une troupe qui l’adorait.
J’eus l’impression qu’elle attendait que j’acquiesce.
Il y eut un long temps vide. Je dessinais des traits parallèles dans le sable. Ma belle nageuse semblait plongée dans des pensées insulaires particulièrement ianvouables. Elle se redressa, se serra dans son peignoir et se leva d’un bond .Elle rangea très vite ses affaires dans son sac de toile et fila vers le remblai, puis elle m ‘adressa un petit signe amical furtif en abordant la route .
Sa silhouette me reste dans la rétine. Je ne la revis jamais.
Quand je passe désormais devant la villa à l’abandon , je m’aperçois que les averses de l’hiver, et les innombrables printemps pluvieux ont laissé des taches noires et grises sur la façade . Le bleu pâle des volets s’ est écaillé, la grille rouille, un séchoir à linge pend au balcon du premier étage et des fientes des mouettes balafrent de leur plâtre les vitraux de la tourelle nord.Un canapé aux pieds torsadés et aux coussins recouverts de tissu écossais a disparu il n’y a pas tres longtemps.Les herbes folles et des graminées tres hautes ont enfoui les pelouses où elle flânait avec son lapin blanc. Les cirrus floconneux et lourds d’orage menacent la presqu’île ces jours-ci et plus particulièrement cette villa, avec son grillage cadenassé.Un panneau de l’agence immobilière « Gilbert Plennec » a été accroché récemment.