Quand, en mai 1925 Virginia Wolf publie » Mrs Dalloway » simultanément en Grande Bretagne et aux États-Unis,ce n’est pas la première fois qu’apparaît ce personnage .Clarissa et Richard Dalloway apparaissent dans « Traversées » dix ans auparavant . C’est un couple de snobs.Lui est membre du Parti Conservateur qui a perdu son siège au Parlement, et elle,Clarissa est une brillante mondaine qui a la répartie brillante , étalant ses références culturelles. Une intéressante nouvelle « Mrs Dalloway dans Bond Street » est publiée en 1923. On retrouve déjà la marche sur les trottoirs encombrés de Bond Street une femme snob qui cherche à acheter des gants et multiplie les « états de conscience ». On retrouve les principaux éléments du roman .
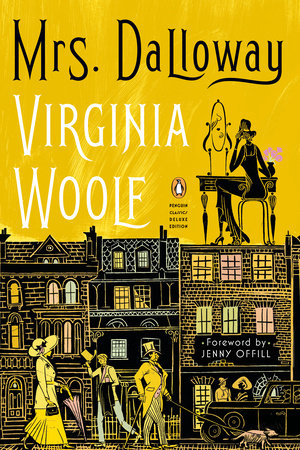
Nous sommes à Londres au mois de Juin . Par une claire matinée de juin Clarissa Dalloway sort dans Bonds Street pour acheter des fleurs et en orner sa maison pour la fête qui s’y tiendra dans la soirée. .le teste enregistre le flux de sa conscience, dans son regard, et tous les petits impacts sonores qui l’assaillent .Sentiments, sensations lumineuses, kinesthésiques images et scènes du passé , conversations, qui reviennent , prises dans une sorte d’euphorie printanière. Le décousu ajoute au charme. Réminiscences diaphanes questions politiques qui préoccupent son mari député : Clarissa se souvient de P, regrets de n’avoir pas épousé son amour de jeunesse, Peter Walsh, le monologue intérieur et ses expressions familières, un sens aigu du ridicule pour décrire les personnages que Clarissa croise, « l’air vibrant d énergie » entre Arlington Streets et le Mall les croisements d’images insolites(le visage fardé d’une grosse dame et les lignes des poteaux télégraphiques, ou bien les taches sur le bras d’une vendeuse qui rappelle à Clarissa les milliers de jeunes gens morts dans les tranchées d’Argonne) , et malgré le scintillement de l’espace, son côté oh le beau jour d’été qui métaphorise et renvoie ce quartier huppé de Londres à une sorte de vitrine de bijouterie scintillante; on note surtout une exploration survoltée , une hypersensibilité écorchée ,une femme se débat dans un vide miroitant peuplé d’ancêtres tombés en poussière , d’absents, de disparus, de soldats morts, de chagrins ajoutés à une chanson sifflotée par un jeune passant. Au milieu de ce charroi printanier bruyant et étincelant Mrs Dalloway subsiste, allègre. Elle s’abandonne à de sinistres présages mêlées à une effervescence poétique où des étendards anciens d’une armée héroïque et fantomatique se superposent à un banal prospectus publicitaire . Le mélange de lumière saturée d’images éclairs et la rapidité kaléidoscopique, qui dynamisent sans cesse la prose, sont aussi le résultat d’une inquiétante hyperactivité mentale . On devine que l’ euphorie étrange de Clarissa qui doit être couronnée par une fête mondaine le soir peut tourner à une affolante crise d’hystérie parmi le bla-bla snob des invités.
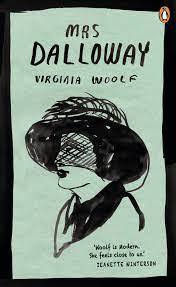
Littérairement, un éclatant évènement : Virginia balaie le roman traditionnel anglais victorien . le même flux libre et complètement neuf dans le roman anglais de l’époque., comme si ,en filigrane, les névroses explorées par Freud (que l’éditrice Virginia Woolf publiait avec passion) imprégnaient le texte. Dans son « Journal » et ses lettres de l’époque V.W. mentionne Proust avec enthousiasme et ne cache pas son influence sur ce qu’elle écrit.
Le cinéma mental mêle avec un chatoiement d’images charmeur le présent de la rue, ses bruits, ses voix, rencontres. La subjectivité désordonne la réalité solide et immédiate de la marche avec ses bouffés, à une fièvre envahissante. Ce que ‘l’auteur appelle dans son Journal « des moments d’être » envahissent la conscience brise et émiette le temps des horloges.
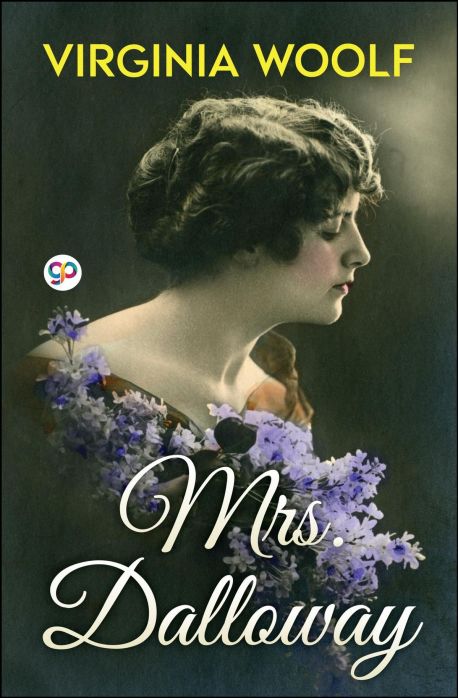
C’est dans « Mrs Dalloway » qu’elle pousse le plus loin l’expérience de « moments extatiques ». On se souvient que c’est dans « Le Temps retrouvé » que Proust les réunit ces moments : la sensation du pavé mal équarri, le bruit d’une cuillère contre une assiette, le grain d’une serviette empesée, qui transportent le narrateur successivement aux pavés de la basilique St-Marc à Venise, au bruit métallique entendu dans un train entre Cabourg et paris, et à la serviette rêche utilisée à Balbec.» Clarissa Dalloway, quand elle sort de chez elle, ressent le même phénomène : un bruit de gonds et la fraîcheur de l’air la transportent trente ans en arrière, dans la maison de Bourton, au bord de la mer, où elle a passé les étés de son enfance.
Elle écrit :« La bouffée de plaisir ! Le plongeon ! C’est l’impression que cela lui avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds, qu’elle entendait encore, elle ouvrait d’un coup les porte-fenêtres, à Bourton, et plongeait dans l’air du dehors. Que l’air était frais, qu’il était calme, plus immobile qu’aujourd’hui, bien sûr, en début de matinée ; comme une vague qui claque ; comme le baiser d’une vague ; vif, piquant, mais en même temps (pour la jeune fille de dix-huit ans qu’elle était alors) solennel »
Le critique littéraire Max Pol Fouchet a bien cerné les personnages de Virginia Woolf : « Si vous vous fondez sur le « caractère » » ou le pittoresque pour les reconnaître, vous ne les verrez pas, vous ne les rencontrerez jamais. Ils sont, si j’ose dire, impressifs et non pas expressifs. Ou plutôt, s’ils sont expressifs c’est de ce qui ne s’exprime pas. De merveilleuses méduses et délicates, portées par le flot jusqu’à nos rives, pour témoigner des mêmes abysses et de l’unique profondeur. »
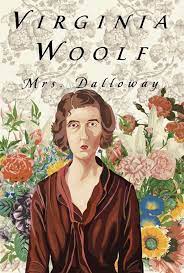
Mais, au-delà de Proust et ses phrases gigogne, filées avec du sucre caramélisé, Virginia Woolf rend elle sa prose aquatique. L’image des vagues, revient sans cesse, car les phrases , telle les vagues, charrient , se superposent, s’étalent, se balaient, l’écume des sensations s’évapore, un soleil multiplie les reflets et facettes, remous de prémonitions, souvenirs. Sa prose coule, ruisselle, vivifie, miroite, au fil des livres, des titres (« les vagues », « Vers le phare ») forme un impressionnant flottement, vune dérive dans la profondeur des sentiments cachés ou devinés. Tout est saisi dans la torpeur d’une eau qui remue sans cesse et qui fascine un enfant au bord de la mer. La narratrice nous glisse sous la ligne de flottaison de la conscience lucide pur révéler ce qui blesse, écorche cette conscience et la saisit dans sa fragilité. L’écrivain nous murmure ceci :»Car c’est cela, la vérité en ce qui concerne notre âme, notre moi qui, tel un poisson, habite les fonds marins et navigue dans les régions obscures, se frayant un chemin entre les algues géantes, passant au-dessus d’espaces tachetés de soleil et avançant, avançant toujours, jusqu’à plonger dans le noir profond glacé, insondable ; soudain l’âme file à la surface et joue sur les vagues ridées par le vent ; c’est-à-dire qu’elle éprouve l’impérieux besoin de se bouchonner, de s’astiquer, de s’ébrouer, à écouter des potins… Qu’est-ce que le gouvernement avait l’intention de faire (Richard Dalloway serait au courant) quant à la question de l’Inde ? »