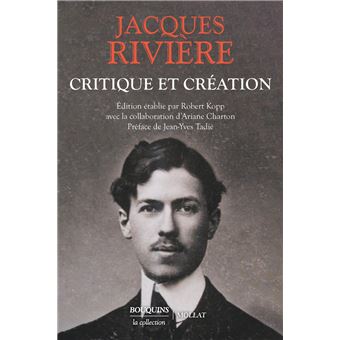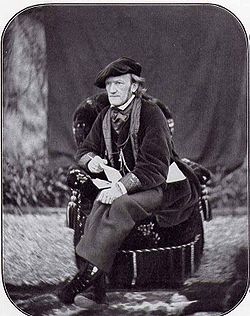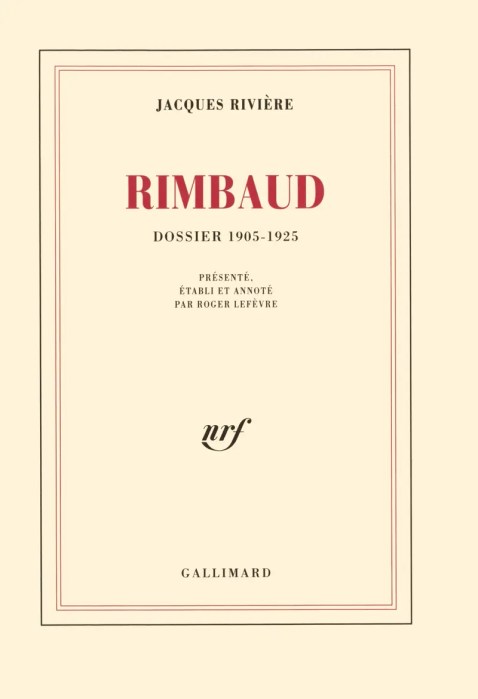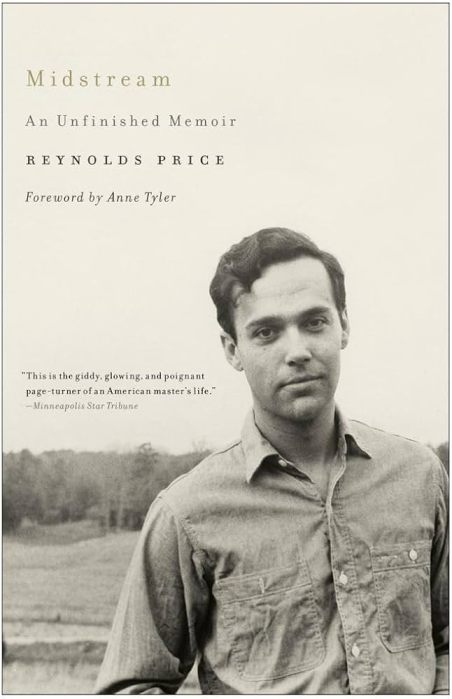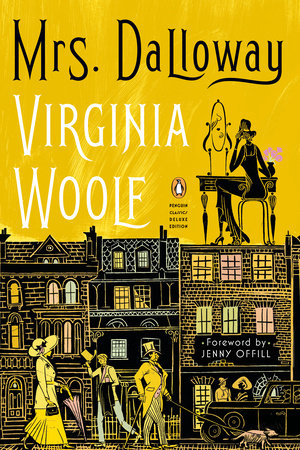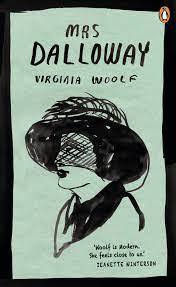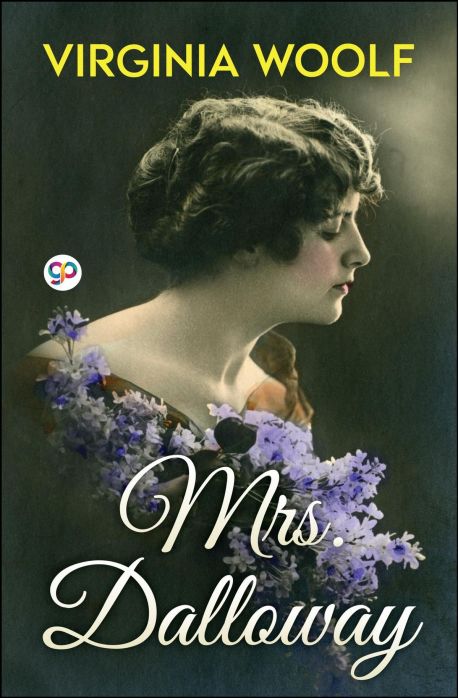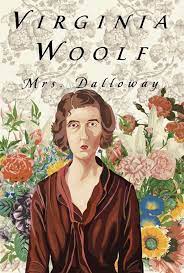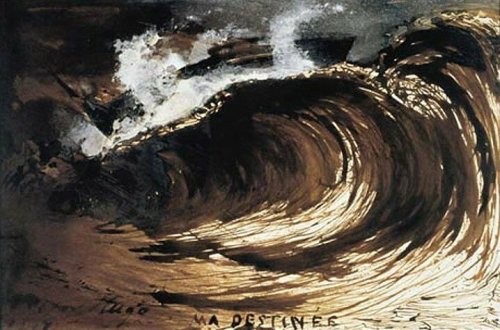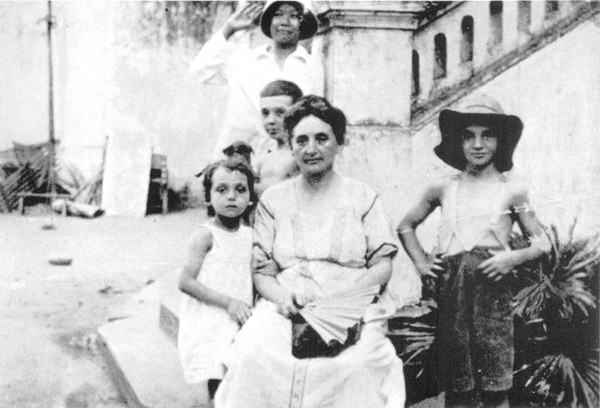Depuis une semaine , chaque matin vers huit heures , je guette ma baigneuse préférée. Elle nage au milieu de vagues courtes entre les rochers.Quand elle revient vers la plage la nonchalance de sa démarche sa silhouette gracile d’adolescente me plaisent. Je l’avais aussi remarquée lundi dernier sa gaieté pour aider un petit garçon de huit neuf ans à finir de construire son château de sable.J’avais aimé sa patience pour décorer les tours avec des coquillages roses ou bruns.La nuit tombait,la plage était désertée, mais tous les deux , seuls, tranquilles, achevaient leur travail sans se soucier de l’heure.

Chaque matin, donc, je la guette. J ’y repensais hier alors que je prenais un rosé de Provence au Bar des Mouettes .
Je sais par Fred ,le garçon de café qui me sert des ballons de rosé, que cette jeune femme s’appelle Constance ( Constance de quelque chose …) et qu’elle a un fils , Marc-Florian , qu’elle mène à l’école de voile en début d’après-midi. Il m’a également dit avec un air entendu qu’elle était « à la colle » avec Jérôme Lehanneur « un ponte de la radio ».Il ajouta « Europe 1 je crois ».
J’appris aussi que ce patron de radio avait l’habitude de siroter des Martini au bar de l’Hôtel d’Angleterre avec ses amis golfeurs.
Fred avait ajouté :
– Ses potes de golf ont l’habitude de vider les soucoupes de cacahuètes pour les donner à manger au perroquet, Arsène, qui répète « T’as payé ?!! », « T’as payé ?!! » dés qu’un client sort du bar.
-Vous en savez des choses Fred.
-C’est mon job.
Il avait ajouté :
-Ils sont tous dans les assurances, la banque, la restauration haut de gamme,la grande distribution . Il y en a deux qui dirigent des chaînes hôtelières. Ils se retrouvent au Golf.Mais au PMU ils jouent leurs propres chevaux.
Je sais aussi par Fred que Constance et Jérôme occupent la villa à colombages, Ker Villette , de style normand. Elle est à cent mètres de chez moi. Sur le portail, on remarque une discrète camera. Dans le jardin et ses allées cerné de buis il traîne toujours un vélo d’enfant, et deux ou trois balles de tennis . Chaque matin, je vois une femme de ménage en blouse bleue déplier quatre chaises longues face a à la mer. Elle baisse les stores rayés de toutes les chambres à onze heures pile , même quand le ciel reste incertain. J’ai vu également un soir le « compagnon « de Constance sur la terrasse, un type massif avec une crinière de cheveux gris mal débroussaillés.Il portait un polo rose pale sur un pantalon clair tout mou en lin froissé et des espadrilles délavées. Il avait saisi une paire de jumelles pour scruter le ciel à la recherche d’un drone dont on entendait le bizarre ronronnement au dessus des toits des villas

J’en étais à mon deuxième verre de rosé au Bar des Mouettes lorsque ma nageuse préférée débarqua sur la terrasse avec une raquette de tennis sous le bras. Elle se dirigea droit vers ma table, s’assit tranquillement à ma table,comme si elle me connaissait depuis longtemps.
-Bonjour, dit-elle,je m’appelle Constance.C’est vous qui logez dans la maison blanche avec des roses trémières ?
-Oui, la toute maison blanche à toit plat .
-Vous aimez bien me regarder .
Elle mordillait une branche de ses lunettes de soleil.
-Passionnément.
-Vous n’êtes pas un peu voyeur ?
-Absolument.
Elle commanda un verre de lait à Fred.
De prés, elle avait un visage plus rond , un nez tout petit,une bouche étroite rouge cerise destinée sans doute à débiter des remarques impertinentes.
– Vous ne vous baignez jamais ?
-Jamais.
Un enfant de sept ans en ciré jaune marchait sur le muret de la digue en étendant les bras.
-Votre fils ?
-Non,Marc-Florian est le fils de Jérôme… Sa mère est antillaise.
Je penchai mon verre de rosé pour surveiller un moucheron. Constance se pencha sur la pile de journaux posée sur la table.
-Vous lisez tout ça ?
-Oui, ligne à ligne.Chaque matin.
-Vous êtes journaliste.
-C’est ça. Je suis journaliste.Un journaliste c’est un type qui lit les journaux.
– On, m’a déjà dit ça.
-Jérôme ?
-C’est mon compagnon. Il a une théorie sur les journalistes: ce sont des cannibales, ils se mangent les uns les autres.
-Ah.
-Oui, je veux dire qu’ils se copient les uns les autres. Ou bien ils recopient la presse étrangère. Ils se mangent quoi.
-Ah.
-Vous n’êtes pas bavard.
-Je réfléchis aux vertus intellectuelles du cannibalisme.
Fred apporta le verre de lait.
-Vous travaillez pour quel journal ?Ouest-France ? Le Télégramme ?
– Le pays Armoricain.
-Et vous m’observez chaque matin ?Sans vous lasser?
– L’eau est votre élément. Vous êtes Ondine.
-Alors venez nager avec moi.
-Je ne sais pas nager.
-Moi je ne sais pas conduire.
Un nuage passa devant le soleil .
-Vous jouez au golf ?Au tennis ?
-Non plus.
Je m’aperçus que Constance attirait les regard de deux types en survêtement et en sueur, assis devant leurs chopes de bière.
– Nager procure des sensations formidables.On se sent léger comme les types qui marchent sur la lune.
-Vous connaissez Buzz Aldrin ?
-Pourquoi ?
-Lui a marché sur la lune.
-Vous ne voulez pas apprendre à nager ?
-L’eau est trop froide, il y a des trucs mous qui vous passent entre les jambes , et puis tant de chiens pissent dans la mer.
Pour qu’un silence ne s’installe pas et devienne gênant je dis :
-Vous vous occupez bien de cet enfant..
– Marc-Florian n’est pas mon fils.C’est le fils de Jérôme.
-Qui n’est pas votre mari.
-C’est ça.
-Qui ne nage pas.
-C’est ça.
Elle examinait le pourtour de sa raquette de tennis.
– J’ai envie d’en avoir un.
-Un mari ?
-Non, un fils.
Elle posa sa raquette sur mes journaux.
-Mais je n’ai pas encore trouvé le père.
-Je vous ai vu un soir construire un château de sable. Avec cet enfant c’était un spectacle charmant.
J’ ajoutai :
– Quand le Covid a commencé et que tout le monde s’est terré chez soi,la côte est devenue vide et merveilleuse , les plages désertes à perte de vue avec des cormorans filant droit au ras de l’eau, et des goélands. Il y eut même un héron cendré qui venait à marée basse , il est devenu mon ami.J’aimais aussi les bernaches , en file indienne. Aucun humain,le rêve.
Elle porta à ses lèvres une cigarette fine avec un léger tremblement dans la main. J’approchai un pavé de verre qui devait être un cendrier.
– Pendant longtemps j’ai été grand reporter.
-Oui ?
-Spécialisé dans les concours des châteaux de sable.
Je crois que ma mauvaise blague est tombée à plat .
Je saisis le tas de journaux posé sur la table et me mis à les replier soigneusement.
-Vous ne lisez que des journaux ?
Je tirai de la poche de ma veste un livre de poche écorné.
Elle se pencha et lut :
« Herzog » de Saul Bellow.
-Fascinant.Moi mon personnage préféré c’est Ramona.
Elle feuilleta et découvrit de nombreuses pages noircies par mes notes.
– Vous avez lu « Herzog » ??!
-Ça vous surprend ?
-Que quelqu’un puisse lire Saul Bellow ici ,oui..

-Il n’y avait pas, un million de chances sur..
Elle suspendit sa phrase.
-Vous vouliez dire : » il n’y a pas une chance sur un million que vous rencontriassiez un fou de Saul Bellow sur cette plage , et même sur toute la côte.
Constance feuilleta le livre de poche longtemps. Je trouvai à ses gestes une grâce adolescente. Elle fit tomber une petite photo carrée dentelée en noir accolée à une vieille feuille de papier carbone. Elle ramassa la photo.
-Mes grands parents. Irma et Auguste.
J’ajoutai :
-Ils s’éloignent .Plus je je vieillis, plus je pense à eux,plus je les aime.Ils me manquent.
Elle replaça avec soin la photo au milieu du livre.
-Je crois que leur génération aimait davantage les petits enfants,les enfants, la vie en général , que ma génération.
-A quoi ça tient ?
-Je ne sais pas. Les guerres…Leur ville a été rasée.
Elle referma le livre.
– Mon livre préféré ça reste « La planète de Mr Sammler. » Vous savez, quand le grand noir montre sa queue dans un bus.
-Ah oui. La sauvagerie urbaine américaine.
Des nuages s’étendaient uniformes sur la mer qui n’avait plus de couleur. Marc-Florian et son ciré jaune avait disparu. On entendait des exclamations venant de la plage , sans doute des volleyeurs vers le casino.
– C’est vrai que tous les journalistes rêvent d’être écrivains ?
-Absolument .
J’ajoutai :
-J’écris toutes les nuits et je déchire le matin ce que j’ai écrit avec enthousiasme au cours de la nuit. Je suis comme Pénélope, la femme d’Ulysse.
-Je sais qui est Pénélope.
Il y eut un froid Elle baissa ses lunettes de soleil sur le nez :
-Je sais qui est Pénélope.
Elle alluma une cigarette étroite avec un curieux briquet laqué noir qui datait des années 6O.
-Votre travail consiste en quoi ?
– Des articles sur les pots de départ en retraite d’un gendarme, l’anniversaire d’une centenaire frisottée dans son Ehpad , l’ado qui flanque la voiture de son père dans un fossé en sortie de boite,les variations du cours du cochon et de la queue de lotte ,l’ouverture d’un salon de coiffure, le nouveau point de deal devant la Poste, la fête du blé, la réunion houleuse du conseil municipal , etc etc..
– Emmerdant.
-Pas du tout. C’est la vraie vie, les vrais gens. Simples. Je les aime.Ils ont souvent beaucoup de dignité. Ils vivotent avec des petites retraites, ils préparent la fête du quartier avec beaucoup d’entrain , ils organisent des tournois de belote, enfilent des bottes et grattent le sable aux grandes marées pour trouver des coques. Ils s’occupent des enfants des autres. Oui, je les aime vraiment beaucoup.
Elle leva ses yeux d’un vert translucide.
-Vous les idéalisez.
-Pas du tout.Il ne faut pas les mépriser.
-Je ne méprise personne.
Le malaise s’accrut entre nous.
Pour rompre le silence, Constance dit :
– Jérôme passe sa vie au Golf .
-C’est lui qui a la Porsche gris métallisée ?
-Non, il a la Jaguar café au lait.
-Il dirige vraiment Europe 1?
– Depuis trois ans.
-Et avant ?
-Dans les Assurances.
L’atmosphère changea un peu.La lumière devint plus vive. Les balcons des villas alentour se mirent à briller, des moineaux sautillaient sous une table.

Enfin il se passa quelque chose : un caisson d’acier à couvercle bleu s’envola dans les airs, suspendu par un bras métallique d’un camion des services municipaux. C’était le jour des poubelles. Constance était délicate et charmeuse en jupe plissée .Sa peau était d’une pâleur étonnante. Elle avait plusieurs grains de beauté sur le bras gauche et une minuscule cicatrice dans le creux du cou.
-Je dois aller au Centre Leclerc.Vous m’accompagnez ?
-Non, je finis mon rosé de Provence .
Elle écrasa sa cigarette dans le pavé en verre.
-Vous devriez venir ce soir. Jérôme donne un petite fête pour ses amis golfeurs . Une cocktail partie.Ils ont gagné une coupe . Je vius in,vite officiellement. Vous avez un téléphone ? Et vous savez vous en servir ?
-O6 98 43 44 13…
Je cherchai un stylo dans les poches de ma veste.
– Pas la peine, j’ai une bonne mémoire.
-Vers quelle heure ?
-A partir de sept heures.
-Vous êtes sûr ? Je peux venir ?
-Oui, si vous cachez soigneusement votre goût pour Saul Bellow.

Le soir même, le ciel avait blanchi avec quelques nuages gris bien parallèles. Le temps devenait lourd avec des moucherons.
Quand je traversai le jardinet,j’avais changé de chemise et enfilé un blouson de daim, brossé mes baskets . J’entendis de loin des voix graves,puis une cascade de rires venant de la grande pièce .
Quand j’entrai dans le grand salon cette antre obscure me parut pleine d’hommes d’éclats de voix et de fumée. Des silhouettes ventripotentes, des quinquagénaires rigolards,des femmes mûres trop maquillées,papotaient en buvant du champagne rosé. Deux longues tables aux nappes blanches damassées étaient garnies de plateaux avec pas mal de toasts au saumon , aux crevettes et avocats.Il y avait aussi de curieux hamburgers qui débordaient d’une pâte gluante couleur moutarde. Les coussins sur des chaises Empire au dossier éraflé étaient imbibés de poils de chat. Deux pieds de lampes Art Déco en pâte de verre orange supportaient des abat- jours genre champignons phalliques.
Trois serveurs en veste lie de vin, galonnés d’or aux épaules , circulaient avec des plateaux garnis de flûtes de champagne.
Quatre invités en blazers avec écusson étaient debout ,tous presque chauves, groupés autour d’une cage avec un perroquet qui sifflait » T’as payé ?!!.., T’as payé ?!!.. «
Près de la cheminée ,une jeune femme avec une chevelure châtain coupée tres court se détourna d’un un homme aux joues rouges, imposant , dans une chemise saumon . Grace à sa coiffure grise, assez crinière de lion, je reconnus l’homme aux jumelles , le patron d’Europe 1, le compagnon de Constance.
Il s’adressa à une femme assez âgée, le visage nu,cheveux gris mal taillés. Elle tenait sa tête en arrière , sa robe de bure raide cachait ses formes .Elle portait de curieuses sandales aplaties et usées ce qui la faisait ressembler à une religieuse retournée à la vie courante. Elle écoutait froide, énigmatique ce Jérôme qui racontait qu’il ne voulait plus de ce « crétin qui présente la météo comme on présente un match de foot ».
Prés du couple , les fumeurs à blazers étaient en train d’échanger ce qui ressemblait à des cartes bancaires. L’un d’eux rajusta son nœud papillon.
Je cherchai Constance du regard .Pas de Constance. En revanche, une femme à ample chevelure noire à reflets gras, habillée d’une chemise d’homme savamment déboutonnée, de manière à découvrir sa peau, allant de sa gorge généreuse à son nombril, était en train de déchiffrer quelque chose de dessiné sur une balle de tennis. Elle portait aux oreilles de grands anneaux d’or style gitane . Je lui trouvai une vague ressemblance avec Constance. J’appris plus tard que c’était sa sœur jumelle.
Un grand type à tête carrée énergique et coiffure gris en brosse , en chemise hawaïenne, me tendis la main et marmonna un nom qui était compliqué et d’assonance anglaise. Il me tendit une flûte de champagne escamotée dans le plateau qui passait entre nous .
-Tout se passe bien ?
-Parfaitement bien.
-Vous étiez au Golf ce matin ?
-Non.
-Il m’a semblé vous y voir.
-Je n’y étais pas.
– Vous êtes sur ? J’ai fait un parcours sympa, cent huit. J’ai eu quelques coups potés chanceux. Heureusement ,j’en suis à ma 79ème leçon.
Un portable sonna. Mon interlocuteur fouilla dans ses poches fébrilement.
– Quelqu’un vous appelle pour vous féliciter.
– Il parait que Constance vous a séduite.
Je n’eus pas le temps de répondre. La chemise hawaïenne avait disparu dans le grand jour de la terrasse pour écouter ce qui devait etre un long message.
Je déambulais dans la pièce . Plusieurs vases en pâte de verre étaient soigneusement alignés dans un niche avec deux spots qui diffusaient une lumière trop intense à mon goût.
Une table basse supportait un service à café de porcelaine aux formes géométriques. Il y avait de la poussière au fond des tasses. Une jeune fille à la chevelure châtain coupée à la garçonne , pull ras du cou prune, me dit :
-C’est une table en orme massif signée de Pierre Chapo. Une fortune.Le service est Bauhaus.
– J’aime . Le service.
Elle s’esquiva avec un pas de danse et une ondulation parfaite. Les canapés modulables dans l’angle offraient de beaux gris. Et sur le mur, une tapisserie genre Aztèque suggérait quelque chose de sanglant. Deux fauteuils Chippendale, étaient occupés par des femmes plantureuses avec des robes à grandes fleurs exotiques.J’essayais d’imaginer l’époque quand elles étaient les jeunes filles fluettes en bleu pensionnat. Leurs mains disparaissaient sous des bagues.
-Depuis quelques jours, je n’arrive pas à contrôler me genou gauche,dit l’une.
-Manque d’omega 3,dit l’autre.
Quelqu’un posa ses mains sur mes épaules et murmura .
-Ne bouge pas. C’est moi.
C’était Constance.
Elle portait un curieux ensemble rayé blanc et bleu qui ressemblait à ces anciennes toiles à matelas.
-Tu veux voir ma chambre à coucher ?
Ce soudain tutoiement ce fut comme si elle m’avait embrassé à pleine bouche devant tout le monde.
-J’ai un petit Marquet. Les quais de la Seine. Au dessus de mon lit.
-On dort mieux avec un Marquet dans sa chambre ?
– Viens.
Elle me saisit fermement la main.
-Je préfère pas.
-Pourquoi ?
-C’est une claire invitation sexuelle. Je refuse.
Elle m’entraîna vers une table pleine de bouteilles et de types qui se goinfraient de minuscules sandwichs.
-Viens Je vais te présenter.

La plupart étaient bronzés artificiellement comme s’ils revenaient tous de Miami ou des Seychelles ,sauf un, maigre,glabre, aux pommettes aiguës. Une longue barbe en pointe, lui donnait une allure un peu Méphistophélique. On aurait dit un Greco . Constance me présenta.
-Monsieur Gilles de Kermassat, il possède les deux plus beaux bowlings de la Côte.
-Vous êtes ?
-Jacques, dis-je sobrement.
-Et dis lui Gilles comment tu as fait fortune ?
– Je n’ai pas fait fortune.
-Gilles est d’une famille modeste, il a vendu, pendant 40 ans, des homards à tous les restaurateurs de la côte. Aujourd’hui il a une des plus belles villas de Saint-lunaire.
-C’est vous le journaliste ? J’ espère que vous n’êtes pas en service commandé. C’est privé ici.
Je ne répondis rien.
– Vous êtes déjà célèbre , Jérôme et Constance m’ont parlé de vous il y a deux minutes. Je vais vous dire, les canards du coin répètent tous que mes bâtiments ne sont pas aux normes. Parfaitement faux.
Il parlait les mains dans les poches, l’air à la fois évasif et fatigué en agitant ce qui devait être un trousseau de clés.
Il salua de loin une femme boulotte avec un caniche.
-Il y aurait beaucoup à dire sur la presse régionale.Excusez moi.
Il nous quitta alors qu’ un fracas cristallin fit cesser les conversations. Il y eut un remous du côté des gros blazers. J’aperçus une jeune femme enceinte, avec un chignon en désordre, dans un robe d’un rose dragée, elle s’essuyait un bras couverts de vin rouge avec un minuscule mouchoir en papier.
Derrière moi j’entendis une voix traînante et grasseyante :
-….Vous savez cette histoire de… « détail de l’Histoire ».. si on y regarde de près, dans une certaine perspective.. c’est pas faux du tout..le vieux père Le Pen n’était pas si fou que ça…
L’homme parlait à une femme en robe violette tricotée(elle ressemblait à la princesse Anne d’Angleterre) qyuu lui serrait la poitrine. Ses yeux étaient soulignés de cernes lourds.Elle tenait serré un sac à main à chaînette dorée. Lui, il avait côté trapu, un visage slave et pâle avec des cheveux d’un blond blanc clairsemé qui tombaient en mèches rares sur ses oreilles. Il avait noué un pull blanc sur sa chemise Arrow.
Il reprit :
-Comparée à la seconde guerre mondiale..et à ses enjeux énormes… il faut ramener ce qu’a dit Jean-Marie… à ses vraies proportions… « un détail de l’Histoire ». ..je dis bien dans une certaine perspective.. dans un certaine perspective…
Il se mit à toussoter .
-Et.. et.. Roosevelt n’avait pas tort..il a clairement dit que bombarder les camps nazis n’était pas une priorité…Le vieux Jean -Marie…je le comprends…Pas vous ?..
Comme la femme ne lui répondait pas , il se mit à tourner sa chevalière.Il s’adressa à Constance :
-Vous savez que j’ai rencontré Eric Ciotti la semaine dernière… A la buvette de l’Assemblée… eh bien il gagne à être connu.. physiquement il en impose…
Constance intervint :
-Ciotti ? Il vous en impose ? Il devait faire nuit.
Elle se tourna vers moi.
-Il ne faut pas avoir peur des fous.
-Si, quand ils deviennent très nombreux.
L’autre reprenait :
– Ciotti parle juste …il est étonnant ….Il voit loin… Au fond il m’a agréablement surpris..Je crois qu’il faudra compter avec lui dans les années qui viennent…
– Il est temps qu’il rentre chez sa maman, dit Constance.
-Voilà qui est franc ! nota un homme élégant qui s’était approché et avait posé son menton sur les épaules de Constance.
Il me fit penser à ces italiens charmeurs, souvent milanais ,à crinière argentée, costume légèrement cintré, qu’on rencontre dans les inaugurations prestigieuses au Grand Palais.Ils approchent leurs lunettes demi-lune pour regarder un Turner ou un Caravage,comme pour humer le fond du tableau. Son air onctueux, son regard bleu naïf, son sourire en coin indiquait qu’il ne partageait pas le point de vue de l’admirateur de Ciotti. . D’ailleurs, il dit :
-Je suis très heureux que vous ayez trouvé quelqu’un qui va sauver votre cher pays.
Il se tourna vers une femme de la quarantaine radieuse , bronzée dont la robe argentée semblait avoir été mise de travers.
-Comment vas tu Osiris ?
-Écoute Frank, ne m’appelle plus Osiris
-Mais tu as l’élégance même d’ une reine d’Égypte.
Je m’éloignai .Dans une niche éclairée par un spot bleu il y avait de minuscules personnages d’ivoire. En les examinant de plus prés, je vis qu’ils multipliaient des postures érotiques.
Constance me rejoignit et saisit une figurine emberlificotée.
-Ça vient de Siam.
Elle ajouta :
– C’est le cadeau d’adieu de l’ex de mon prochain ex…
– Vous pouvez répéter ? Votre phrase est bien alambiquée.
-Non, c’est une bêtise, je suis un peu pétée. Tutoies moi.
Un type en T shirt rouge brique, avec un bonnet de marin kaki sur le haut du crane saisit Constance par le bras.
-Laquelle des positions tu préfères ? Quand une nana noue ses jambes autour de mes reins moi je jouis.Même mal réveillé. Et toi, tu jouis comment ?
-Va finir ton Martini sur la terrasse Andy.
Il saisit la main de Constance pour en isoler son index.
-J’aimerais sucer toutes ces jolies petites choses.
-Ça suffit Andy !
Il tenta une révérence mais faillit renverser un plateau de verres sales.
-Fous moi le camp !
-C’est mon anniversaire.
-Ça suffit .
Tandis qu’il vacillait entre les invités, je demandai :
-Qui est-ce ?
-Un ami de lycée de Jérôme ,il a mal tourné. Il monte des crêperies dans des endroits où personne ne va.Il n’a plus un rond. Il a fait un AVC à Noël .
Je me rapprochai de la baie vitrée. La plage me parut noire. J’eus, sous l’effet de l’alcool, l’impression que le groupe d’hommes à polos et blazers était en train de s’évaporer dans le miroitement pâle de la mer. Le contre- jour le soir me rappelle de sombres évènements et m’annonce toujours la fin du monde, ou, simplement, l’inexorable approche du grand abîme.
Je scrutais cette génération d’hommes qui avaient « réussi » comme on dit.Ils avaient été trop jeunes pour la guerre d’Algérie et peut-être un peu vieux pour Mai 68. Ils étaient donc dans un trou, un trou générationnel , comme les trous de leurs parcours de golf. Avaient-ils tous des coachs sportifs, des maîtresses à Boston ? Ou ne pensaient-ils qu’à doser leur swing pour expédier une minuscule balle blanche par dessus un bunker ?
Ce qui me frappa c’est qu ‘ils parlaient en écartant les jambes. J’imaginais les collines vertes , joli petit claquement de la balle qui s’élève et fond dans un ciel bleu . J’essayai de les imaginer, jadis, ces braves quinquagénaires,du temps du dernier Chirac. Tous très jeunes,brillants,sortis des leurs écoles, héritiers de leurs grandes familles, brillant d’une suffisance sarcastique. Tous dotés de jeunes épouses enceintes. Je les voyais aussi dans des bars tamisés pas loin de l’Etoile, avec des petites aguicheuses écervelées, qu’ils entraînaient dans des cabriolets Triumph à Pâques ,ou pendant les ponts du mois de Mai vers des Hostelleries cachées au fin fond du Limousin. Baises et viandes en sauce. Je savais que succombais à une jalousie médiocre pleine de clichés. Plusieurs d’ entre eux, s’étaient affalés dans les canapés ,ils goûtaient des glaces aux noix de pécan.
Je retrouvai la femme à ample chevelure noire , habillée d’une chemise d’homme savamment déboutonnée.
Elle me tendit une verrine et sa poudre de cacao
-Je suis la sœur de Constance. Amandine. C’est vous le fou de Saul Bellow ?
-Oui .
– Vous avez impressionné ma sœur.C’est assez rare.
La petite cuillère écartait la poudre de cacao pour atteindre la couche de Chantilly.
-Ne révélez pas vos goûts littéraires . Pas ici.
-J’ai entendu une conversation horrible sur « le détail de l’Histoire » et Jean Marie Le Pen.
-On va vous poignarder ici si on s’aperçoit que vous êtes un intello. .
Elle s’empara d’un verre ballon et l’emplit de vin blanc.
-C’est un de Chateauneuf du Pape blanc.
Elle fit claquer le mot « blanc ».
Il y eut un mouvement bizarre vers les fauteuils Chippendale : une haute femme en robe moulante carmin et ,décolleté profond , fendit la foule pour rejoindre Jérôme qui mimait quelque chose comme un swing. Cette cariatide couleur feu ,chevelure noire en cascade dégageait quelque chose de plein, de charnel, de sain. Ses lèvres très ourlées exprimaient aussi quelque chose d’affamé.
– Albertine Schwieller !Elle fait toujours son petit effet.
-Connais pas.
– Elle débuta chroniqueuse scientifique à France-Culture puis spécialiste de l’Amérique latine, devint directrice des programmes à Radio Bleue. Elle fait le siège de Jérôme depuis des mois, pour devenir numéro 2 de Europe 1.
Amandine prit un ton confidentiel.
-Elle se colle à Jérôme depuis des mois.
-Il résiste ?
– Elle l’assaille de ses seins dressés. Vous devriez aller voir de prés.
-Sûrement pas.
-Ses cils enduits de mascara ne vous plaisent pas ?
Elle ajouta :
-Dans son salon, il y a une toile de Tamara de Lempicka. Elle croit qu’elle est l’image resplendissante de la luxure charnelle.
-Vous êtes dure. –
– Allez lui dire bonjour. C’est une braillonnée
-Une quoi ?
-Une « braillonnée. »… Vous ne connaissez pas cette expression ? Ce sont les coureurs et coureuses de plateaux TV , on les voit sur toutes les chaînes de télé.. de LCI à BFM ou C dans l’air .. Ce sont spécialistes de tout, criminologie, wokisme… bobologie… cuisinologie… connologie…Ils se plaignent qu’on ne les remarque pas assez nos chers rebelles installés , ils nous inondent chaque soir de leurs prétentieuses certitudes.
C’est alors qu ‘éclatèrent à nouveau les intonation du dingo de Ciotti.
-Vous recevez vraiment n’importe qui dis-je.
-Fuyons ,dit Amandine.

En descendant les marches, j’entendis quelqu’un dire :
-J’ai raté mon deuxième putt…
Nous posâmes nos deux verres sur une table de jardin en fer toute perlée de gouttes d’eau. Ça sentait bon .Amandine sentait bon. Ce beau temps,l’éclaircie du soir après la pluie, la présence d’Amandine, la mer immobile et nostalgique, je les recevais comme une bénédiction.
-Vous êtes sérieux avec ma sœur ?
-Il ne s’est rien passé.Il ne se passera rien.
-Soyez gentil avec Constance .
La digue et les villas brillaient après l’averse.