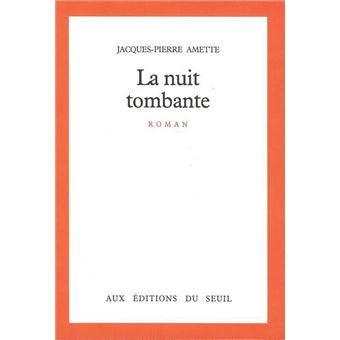Que devient Roger Nimier 63 ans après sa mort le 28 septembre 1962 sur l’autoroute de l’ouest ? La publication d’un Quarto de 1200 pages nous permet une réévaluation de notre insolent en chef des jeunes gens de Droite d’ après-guerre. N’oublions pas, à l ‘occasion que ce brillant cadet sortit du vieux vestiaire Collabo Jouhandeau, Morand, Rebatet et Céline pour les couvrir de paroles affectueuses en oubliant leur antisémitisme.
On redécouvre donc les trois romans a caractère autobiographiques publiés entre 1948 et 1951 « Les Épées », « Le hussard bleu » », « Les enfants tristes ». Soyons honnête, Nimier jette sur le tapis trois cartes maîtresses : insolence, allégresse, désinvolture .
Le Quarto offre aussi les nombreux articles de critique littéraire, des textes introuvables qui défendent Bernanos ou Maurras, c’est le plus passionnant du volume. On goûte la grande intelligence ,le discernement de ces « Journées de lecture » , un modèle du genre. Le Mauriac est d’une grande finesse. Il n’oublie ni le poète, ni la sensualité « ni légère ni facile » de ce chrétien, ni les poèmes les moins lus , les pages oubliées d’« Orages » et de « Province ». . Le Marcel Aymé est parfait. Nimier est moins convaincant sur Bernanos comme si ses curés lancés trop jeunes dans des paroisses avachies l’ embarrassaient . Gide bénéficie d’un portrait si complet qu’il ressemble à une nécrologie au ton feutré pour le journal « Le Monde » . Admiration modérée. Notons ces quelques lignes : »André Gide (..) donnait une assez juste image de l’intelligence et de toutes les provinces voisines : l’honnêteté, la lucidité ,la curiosité intellectuelle. » Il ajoute ceci : »Nous penserons qu’il a été le second dans tous les genres, moins universel que Malraux, moins brillant que Valéry, moins fin que Larbaud, moins profond que Proust. » Pieyre de Mandiargues, Simenon et Jacques Perret sont plébiscités mais jamais dans un aveuglement béat. Les lignes brèves sur l’ami Blondin sont floues ,trop de proximité embarrasse. Il ne faut pas caricaturer le critique Nimier : il appréciait avec élégance les écrivains de l’autre bord, par exemple, le communiste Roger Vailland, et même Jean-Paul Sartre , l’ennemi existentialiste préféré , traité avec des égards.

Stendhal est bien vu « Il accumule les théories de la séduction, les martingales infaillibles de l’amour, mais il meurt seul, et pas une femme, sans doute, ne le pleure. ».
Ouvrant ce Quarto tout frais imprimé, j’ai relu deux romans , « Les Épées » et « Le Hussard bleu ».
« Les Épées » déroute. Beaucoup de pirouettes, une farce écorchée sur le thème de adolescence. On note des remarques incongrûment juxtaposées, un mélange de frivolité et de cris du cœur assourdis pour dire l’inceste avec une sœur . Ce François Sanders est un double de Nimier. Le charme ado, des pénombres attirantes, un visiteur du soir avec un égotisme tendance Drieu – donc bourreau de lui même- et pas mal de vide autour .Nimier cultive dans une langue souple remarquable pour son âge les charmeurs désolés. La médiocrité de la troupe humaine reste une basse continue de tout Nimier, même si on y trouve des joliesses à la Giraudoux.
François Sanders ,si romanesque, je l’imagine plutôt le long d’un bassin du Versailles à papoter avec Madame de La Fayette, ou astiquer son épée en bras de chemise avec Fabrice del Dongo dans la brume matinale du lac de Côme. D’ailleurs ce personnage on le retrouve sur les bords du Lac de Constance . Différence avec Stendhal: ses hussards méprisent les femmes avec des gestes de galanterie et des pensées de soudard.
Dans « Les épées » Nimier se révèle éparpillé, batailleur, plein d’éclat, indompté, virtuose. De brillantes pépites sur une tapisserie sombre de fin d’ adolescence. Nihilisme un peu blasé : « Les hommes ne savent que précipiter ou retarder des situations qu’ils n’ont pas créées. Chacun de leur geste se répercute si loin qu’ils en ignorent le sens. Ils font leur destin, mais ils ne le sauront jamais – ce qui revient à ne rien faire. » Ce Nimier là compose l’épitaphe de la Résistance avec cette flèche :« Dans l’armée française, il y a moins de garçons coiffeurs que dans la Résistance… » faisant allusion aux femmes tondues à la Libération. On résume : « La démocratie ne valait pas les chiottes pour la noyer ».
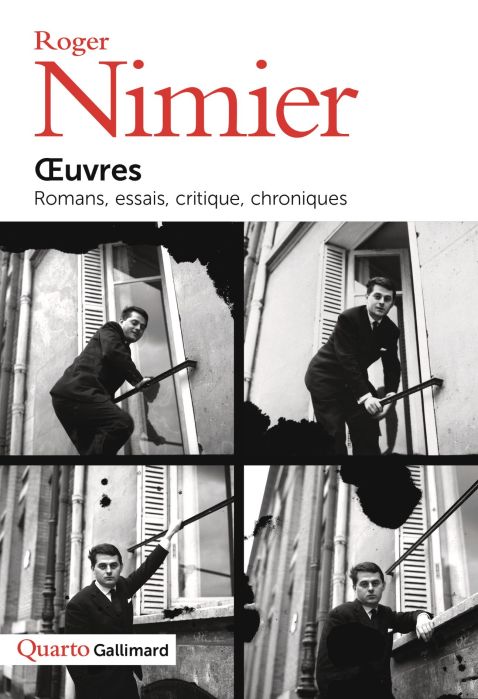
Lire « Le hussard bleu », c’est autre chose.
Paru à l’automne 1950, ce roman d’un auteur de 25 ans éclabousse le Tout-Paris littéraire. Nimier a puisé dans son expérience puisqu’il s’est engagé volontaire à 19 ans au 2eme Hussard à Tarbes le 3 mars 1945.Nimier fut pendant quelques mois radio sur une automitrailleuse stationnée sur la Côte d’Azur tandis que son meilleur ami, lui, Michel Stièvenart, meurt prés de Munich dans l’accident d’un camion militaire. La mort de son ami d’enfance le bouleverse à tel point qu’on peut soupçonner qu’il est la source secrète de ce livre gai-douloureux, amer-clinquant. La tristesse pointe dns un argot qui cree une curieuse féerie scatologique. Le tragique apparait dans le récit d’une embuscade vers la fin du livre: c’ est le meilleur du livre car la tristesse flotte sur un ciel bleu avec de curieuses étoiles en papier alu.
Le roman se nourrit aussi visiblement des lettres de ses anciens amis du 2° hussard qui lui ont livré des compte rendus détaillés de ce qu’est l’occupation militaire française qui traque les derniers débris des divisions nazies réfugiées entre la Forêt noire et le lac de Constance. On obtient des successions de touches réalistes dans un décor de cartes postales à sapins où manœuvrent des soldats de plomb. dans une expédition guerrière qui ressemble parfois à une excursion touristique. La panoplie des personnages reste sous cellophane. François Sanders, déjà rencontré dans « les épées » est le séducteur viril, Don Juan odieux, cassant, mais qui possède une autorité qui fascine la chambrée. Forjac , officier trimballé dans sa jeep se croit toujours dans la bataille de Wagram. Enfin Saint-Anne , garçon incertain, au profil fitzgeraldien a des timidités d’ado pas très sûr de son identité sexuelle. Il garde quelque chose d’un grand Meaulnes en treillis. Il a des bouffées tendres pour Sanders .Son histoires amoureuse avec Isabelle ,la belle allemande qui erre en combinaison dans une villa modianesque, apporte une note romantique dans ce roman plein d’argot bidasse, de souleries au cognac, au gros qui tache et au Cinzano,..
Les jeunes filles , françaises ou allemandes, se ressemblent par des chatteries voluptueuses et provocantes . Des corps trop neigeux et lisses, des contacts au lit en feux de paille innocents.Elles se déshabillent pour apprendre à des blondinets des choses de l’amour bien trop compliquées pour ces conducteurs de half tracks . Nimier accable ses marionnettes de ricanements ou de maximes déplaisantes. « Faut-il violer cette jeune allemande ou s’en faire aimer ? «

L’important pour l’auteur est de nous faire comprendre que l’armée permet d’ échapper aux canailleries des régimes parlementaires, à la vie civile d’une platitude irrémédiable, encombrée d’imbéciles. Les auto-mitrailleuse roulent dans des décors de Noel qui ressemblent à des maquettes en bois vernis. Il manque les trains électriques….La fin de ces curieuses colonies de vacances s’achève avec quelques minces traits d’un vrai sang rouge habilement tracé dans le paysage.

Le livre fermé on garde en tête la rythme syncopé, caracolant, survolté, jeté pour l’épate, avec sa pluie d’insolences pour cacher une scène de comédie amère avec un grand vide autour. . Enfin la voix de Nimier emprunte à l’argot sophistiqué et précieux de Louis-Ferdinand Céline, nous rappelant au passage que Nimier jouera un premier rôle dans la résurrection après-guerre de celui qui sombra dans la haine et l’antisémitisme par ses pamphlets. Il y du clairon à chaque phrase, mais également une mécanisation bizarre de l’humanité, un désir de marquer dans le brillant, sa haine de la Gauche, d’accumuler les trivialités en se persuadant que c’est une manière de garder la pureté de la jeunesse. Pour Nimier, l’âge dégrade. D’ailleurs il abandonnera le genre romanesque pendant dix ans avant de se tuer en voiture. L’âge ne l’a pas dégradé.