Sollers , écrire désormais : » Écrivain français, né le 28 novembre 1936 à Talence (Gironde) et mort le 5 mai 2023 à Paris. » Philippe Sollers est mort il y a presque un an donc. On publie en mars 2024 ce texte ultime et posthume »La deuxième vie ».C’est court,46 pages. Il écrit à l’encre bleue, au stylo, dans la proximité de sa mort, il le fait avec précision, élégance, densité, raffinement.Le lecteur est saisi par l ‘étrange zone de calme qui rayonne et on se laisse entraîner par ces phrases qui ont l’air des naître par temps doux. Équilibre et sérénité . Qu’est-ce donc que cette « Deuxième Vie » ?
« Je n’ai pas été un bon saint lors de ma première vie, mais j’en suis un très convenable dans ma Deuxième. » Ce qui frappe de prime abord dans ce texte c’est qu’il y a à la fois un détachement dans le ton et une secrète fièvre masquée , une passion cachée pour collectionner quelques « épiphanies » de sa vie, ses amours, ses années Venise. Ce récit écrit à l’ombre , sur fonds de néant , scintille comme une curieuse matinée, entre soleil voilé et brouillard, une lumière de lagune ; c’est la beauté si peu raisonnable du texte, son énergie, sa fraîcheur, comme quelqu’un qui pénétrerait dans un nuage blanc. On retrouve le Sollers du « Cœur absolu », de « Studio », de « trésor d’amour »(sur Stendhal),de « Passion fixe », de « Portrait du joueur », ces livres-journaux intimes mélange d’impertinence, de sociologie griffue pour se moquer des français, de la biologie, du conformisme des journaux, et cette franche rigolade qui le prenait pour raconter ces livres d’élevage dont l’époque faisait la promotion dans ses suppléments littéraires .

Dans « La deuxième vie » -avec postface de Julia Kristeva- Sollers reste adossé à l’enfant qu’il fut, adossé à sa sœur aimée, à Bordeaux, guettant en curieux cette humanité terrestre « en phase terminale ».Bien sûr, adossé à deux femmes aimées, adossé aussi à la Bible, c’est évident. Rien de solennel ni de pompeux. La vie devenue un rêve fugitif. Il y a même pas mal de paragraphes enjoués sur le train du monde actuel comme il va,mais vu de Sirius ou d’une chambre silence aux rideaux tirés où l’auteur semble au chevet de lui-même.
L’observateur social ,très Flaubert révisé Sollers, se délecte de la bêtise du Nouveau Siècle. Sollers reste toujours toujours amusé par le cirque littéraire parisien , et précisément, dans ce livre, par l ‘ascension divine d’Annie Ernaux qui « venge sa race » avec un Nobel , et ,bien sûr, le cas Houellebecq dont il dit : »Il va donc continuer à décrire l’effondrement du sexe français ,pour le plus grand bonheur de la presse internationale, qui ne s’attendait pas à un tel cadeau » sa raison ‘être.
On ne peut qu’être saisi par ce mélange d’alacrité, de sérénité sans fleurs, d’impertinence théologique qui imprègne les phrases.
On notera aussi : buissonnier, et une harmonie nouvelle qui pénètre loin.Enfantin, oui, avec, au passage, une idée matinale, l’ éveil passionné d’un nouveau printemps (nous sommes en Mai) une curiosité pour des choses lointaines et oubliées de sa jeuensse .Certains paragraphes, dans leur brièveté , accueillent l’univers avec la simplicité limpide d’un verre d’eau. Aux portes de la mort, il voit le jour naissant sur le Grand Canal »fenêtre ouverte sur les Zattere. »
Pour la teinte froide du texte il subsiste quelque chose des nuits au cours desquelles il a rédigé ces pages. Pour les teintes chaudes , ; on voit« Les objets, en état d’apesanteur, deviennent familiers.Je suis enfin, arrivé là où je devais aller,les indicateurs le signalent. »
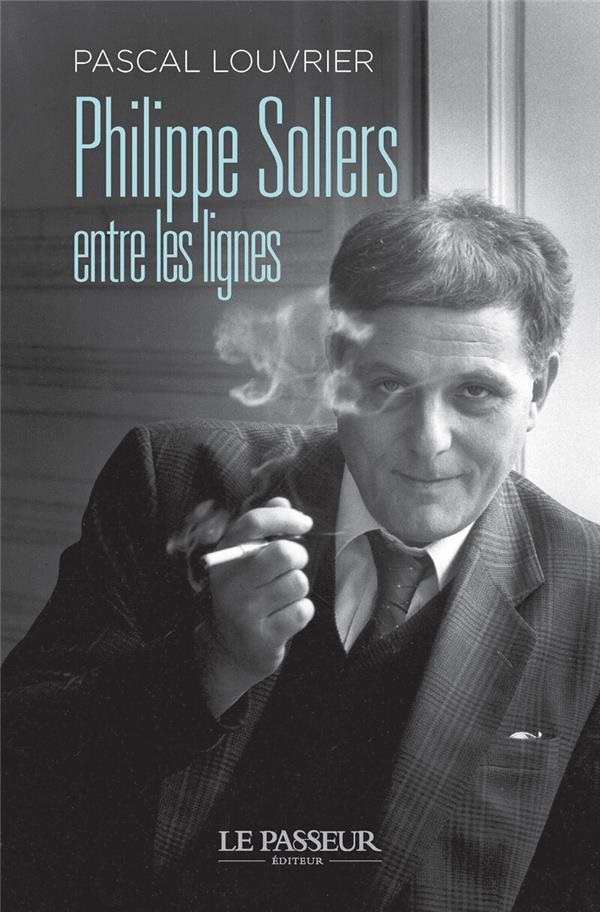
Et aussi : « J’ai été ce fantôme heureux en train de toucher spasmodiquement du bois pour me rappeler qu’il s’agissait bien de ma vie réelle. »
Pour finir, après cette émotion de lecture, avec ce sentiment que monte la marée, une fois de plus, avec nos vivants et nos morts mélangés, un souvenir personnel . Je le rencontrais parfois au petit déjeuner dans une brasserie du boulevard de Port-Royal,au milieu d’une pile de journaux achetée au kiosque voisin. Deux moments :quand il sortit de son portefeuille une petite photo carrée -du noir et blanc- un peu abîmée d’une petite fille assez belle avec regard sombre, dont il me dit que c’était la sœur de Picasso.On la connaissait peu,lui l’avait retrouvée, et c’était toute une gentillesse innocente dans ce geste. Avoir retrouvé ce fin visage mélancolique le rendait joyeux .
Un autre matin, il sortit d’une de ses poches, une reproduction d’un bouquet de violettes peint par Manet. Je dépose donc ce bouquet de violettes sur sa tombe.
Demandez-lui.
J’aimeJ’aime
intéressant rebond sur hyvernaud, paul E. Merci pour lui…
Je ne sais pas si gwen est CP…, MC
Bàv,
J’aimeJ’aime
je me demande si ce ne serait pas victor hugo qui détestait les formules sartrisantes, par hasard. Mais je peux me tromper des poques… Bàv,
J’aimeJ’aime
A propos d’Hyvernaud un des meilleurs articles sur Hyvernaud, je l’ai trouvé sur Amazon, signé Gwen. Rappelons que c’est la revue « les temps Modernes » de Sartre qui publie en premier un chapitre de « La peau et les os », en 1946, et signalons qu’Hyvernaud fut critique littéraire, prof de français à Arras puis Rouen. Il adhère en 1936, à Rouen, à L’Association des intellectuels antifascistes. Voici donc je l’ai trouvé sur Amazon , à propos du « Un Wagon à vaches » et signé Gwen. :
»Georges Hyvernaud: illustre inconnu de la Littérature française? Né en 1902, mort en 1983, voilà en tout cas un écrivain qui traversa nos Lettres tel un météore, semant dans son sillage deux brefs chefs-d’oeuvre qui passèrent en leur temps presque inaperçus, sauf de quelques regards très aiguisés, tel celui de Raymond Guérin. Découragé par l’indifférence accueillant ses textes, Hyvernaud se détournera ensuite de l’écriture « romanesque ». Encore aujourd’hui, en dépit d’une certaine reconnaissance posthume, son œuvre demeure, sinon confidentielle, du moins discrète. Il n’empêche. « La peau et les os », paru en 1949, et ce « Wagon à vaches », écrit en 1953, comptent parmi les ouvrages les plus sensibles et les plus profonds du 20ème siècle et mériteraient d’être considérés comme des classiques, ce qu’ils sont, loin devant certains livres qui les dépassent en notoriété bien qu’ils leur soient nettement inférieurs.
Paru en 53, donc, ce roman nous plonge dans l’immédiat après-guerre. Le narrateur, comme l’auteur, est rentré du conflit mondial anéanti par les cinq années qu’il a passées dans un camp de prisonniers en Poméranie. La guerre finie, la vie normale a repris son cours. Mais peut-on, justement, reprendre une vie normale après un tel cataclysme? Notre homme, en tout cas, y peine. Employé aux écritures dans une vague entreprise d’Eaux Gazeuses, il vivote dans une petite ville de province jamais nommée. A 42 ans, il commence à réaliser qu’il ne fera jamais rien de grand de sa vie, encore que l’idée d’écrire un livre le hante un peu. Comme détaché du monde et des êtres, il subit l’existence avec un mélange d’indifférence fataliste et de curiosité ironique. Déconstruit par sa captivité, il n’arrive pas à se reconstruire et préfère s’abîmer dans une sorte de renoncement philosophique, regardant la multitude s’agiter autour de lui, sans la juger, mais avec une implacable lucidité.
La dimension autobiographique de ce livre est plus qu’évidente, pourtant c’est bien là un roman, même s’il n’a rien de romanesque au sens commun du terme. Pas de personnages héroïques, pas de péripéties, pas d’intrigue (si ce n’est, en fil rouge, l’érection d’un monument aux morts). Non, « Le wagon à vaches » est la chronique d’une expérience humaine, tout simplement, et le portrait d’une petite ville française comme tant d’autres au sortir de la grande catastrophe mondiale. Une petite ville peuplée d’êtres sans relief, engoncés dans leur banalité comme dans un vêtement confortable, ne cherchant pas plus loin que le bout de la rue, là où se trouve le bistrot où ils vont boire leur canon quotidien, jouant leur éternelle belote avec les mêmes immuables habitués. La plume d’Hyvernaud, tel un scalpel, nous dissèque ce petit microcosme d’humanité sans méchanceté, mais avec une acuité confondante, renvoyant chacun à ses propres paradoxes, à ses ambiguïtés, à sa mesquinerie, à ses veuleries, et en définitive à sa vacuité fondamentale.
Ce roman est d’une noirceur considérable, qui pourtant ne verse jamais dans le désespoir. J’ai souvent pensé, en le lisant, à « L’homme au marteau » de Jean Meckert, autre chef-d’œuvre qu’on ne conseillera jamais trop, à certains livres de Bove ou de Calet aussi. Ce que Hyvernaud partage avec ces auteurs-là, c’est que sa noirceur se tempère toujours d’un désenchantement amusé, d’une ironie douce-amère. Il y a des phrases, dans ces pages, d’une beauté et d’une vérité humaine à vous donner la chair de poule, mais d’autres sont d’une drôlerie irrésistible. Puissant par son propos, d’une rare finesse dans son écriture, « Le wagon à vaches » est une merveille d’intelligence et de sensibilité. »
J’aimeJ’aime
PS (Êtes-vous sur qu’on n’est pas redevable à CP de cette exhumation d’ Hyvernaud?)
J’aimeJ’aime
d’ Hyvernaud, je me souviens de«l’Interview. » Pour Sollers que vaut le de Cortanze, trouvé par hasard? Au fait, qui donc a pu ecrire : « L’ Enfer est tout entier dans ce mot, solitude. »? Non ce n’est pas Bernanos…. MC
J’aimeJ’aime
Il faut dire que Paul E. avait su rendre un vibrant hommage à Georges Hyvernaud en son temps quand cet admirable instituteur charentais avait été bien oublié.
Remember « la peau et les os » et « le wagon à vaches », et finissons-en avec le fifil solaire… Les Raymond Guérin ou autres André Hardellet eurent quand même un brin plus d’allure, qu’icelui, non ?
J’aimeJ’aime
une virgule en trop ds le 2ème § & l’on n’y comprend plus rien.
Lire : « il est toujours possible de trouver un rapport »
J’aimeJ’aime
Il paraît que Venise figure parmi les lieux référentiels incrustés ds des paysages imaginaires du métavers « Second Life » (v. Fait et fiction de Françoise Lavocat), mais je suppose qu’il ne s’agit pas de ce type d’hybridation du factuel et du fictionnel.
N’ayant pour ma part rien d’intéressant à ajouter à propos de ce livre en particulier ou de Ph. Sollers en général, & un hors-sujet restant un hors-sujet (même s’il est tjs possible, de trouver un rapport, en l’occurrence le Bordelais), je devrais me taire ; j’espère qu’on ne m’en voudra pas trop de laisser une trace sur cet espace jusque-là immaculé.
Il s’agit seulement de signaler au(x) lecteur(s) des Poulpes de Raymond Guérin, la réédition en un seul volume du neuvième carnet de son journal (11 novembre 1943-6 avril 1944), journal de sa libération de captivité, augmenté de sa suite non prévue Représailles (20 août-20 octobre 44). Une ou deux des facettes de M. Hermès. Le grand Dab dîne chez Paulhan qu’il imaginait plus pauvre, trouve Camus tel qu’il se le représentait à travers ses lettres (mais Leiris très différent de l’image qu’il s’en faisait à travers ses livres), gâche sa rencontre avec R. Queneau & se fâche avec celui qu’il avait cru son meilleur ami (qui, lui, n’a pas connu l’emprisonnement), mais peut s’appuyer sur M. Arland & son ami de captivité, Henri Cartier (qui s’était alors débarrassé du « -Bresson »).
À côté du témoignage sur le vif (& sur certains points ds le brouillard, comme tt le monde), on y trouve ses réflexions littéraires sur ceux de ses romans qui étaient déjà parus, mais aussi ceux en gestation, l’articulation de l’œuvre (totale) qu’il envisage, & la possibilité d’hybridation de la « confession » & du roman (tout dire de soi, de sa vie, tt en évitant de trop éclabousser les autres).
J’aimeJ’aime