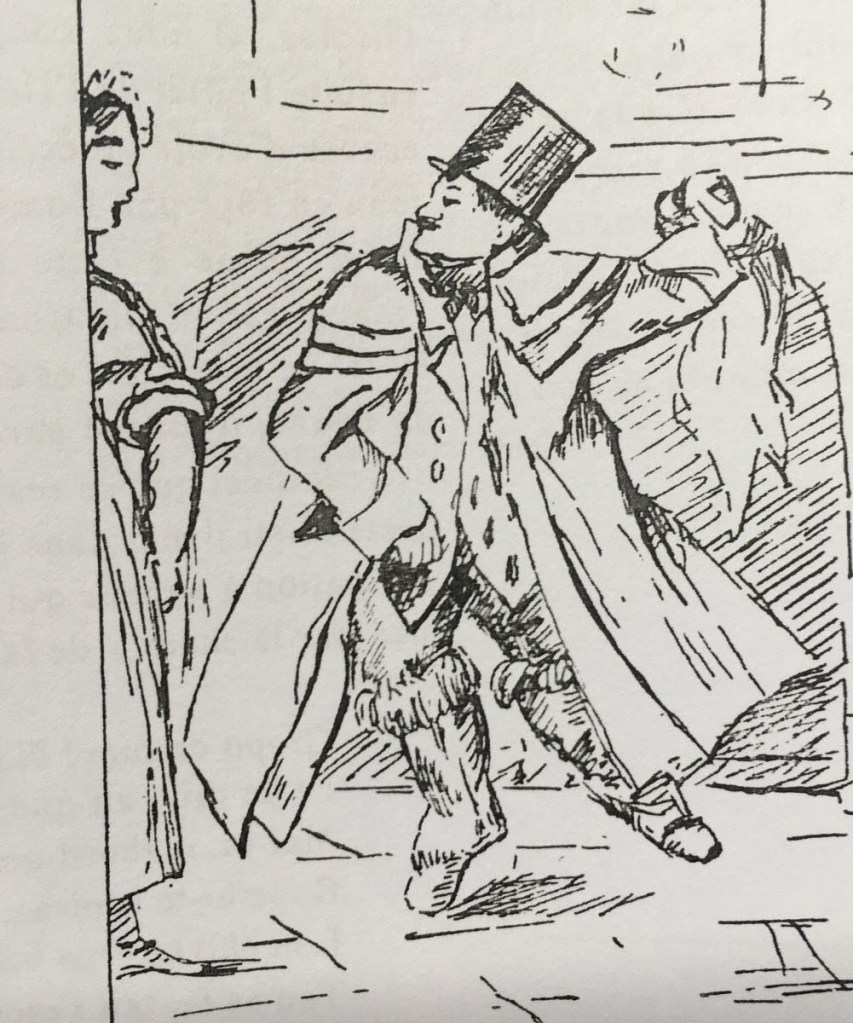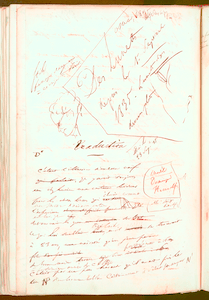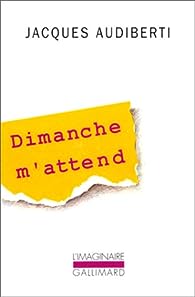« Il m’est très pénible de parler de ce livre, parce que je l’aime.En l’écrivant j’ai rêvé plus d’une fois de le garder pour moi seul… »
Bernanos

Le « Journal d’un curé de campagne » de Bernanos , comment ne pas y revenir ?On assiste à une crise d’un jeune curé parachuté à Ambricourt,dans une paroisse en train de mourir,comme tant d’autres. Qu’on soit croyant ou non, le texte frappe par sa sincérité nue, vibrante, avec des épisodes affolés, assez stupéfiants. Ce texte écrit en Espagne, rassemble un mélange d’angoisse, de solitude, de charité , d’inexpériences et ne cache rien d’une une perte de repères d’un jeune prêtre un peu perdu face à une nuée d’indifférents ou de paroissiens carrément hostiles ; tout ça finit dans une agonie du prêtre qui ressemble à une aube.

Voici ce qu’il exprime ce curé d’ Ambricourt après avoir rencontré des paroissiens qui doutent de lui et qui souvent lui racontent des mensonges .Le sentiment de l’échec pastoral le saisit, d’autant plus fort qu’il y a une double incompréhension :d’abord celle de la hiérarchie ecclésiastique (notamment avec le chanoine de la Motte-Beuvron)qui le déteste. Il n’a comme vrai soutien dans l’église que le curé de Torcy, rusé, roublard, et sympathique et seccond point, il a devant lui la redoutable incompréhension des habitants de sa paroisse .Il confie à son journal intime :
« Je n’ai pas perdu la foi .La cruauté de l’épreuve, sa brusquerie foudroyante, inexplicable, ont bien pu bouleverser ma raison, mes nerfs, tarir subitement en moi-pour toujours,qui sait ?- l’esprit de prière, me remplir à déborder d’une résignation ténébreuse, plus effrayante que les grands sursauts du désespoir, ses chutes immenses, ma foi reste intacte, je le sens. Où elle est, je ne puis l’atteindre. Je ne la retrouve ni dans ma pauvre cervelle, incapable d’associer correctement deux idées, qui ne travaille que sur des images presque délirantes, ni dans ma sensibilité, ni même dans ma conscience. »
Quand on entre dans le pauvre presbytère de ce village d’Ambricourt, en Artois , quand on suit ce jeune curé qui arpente sa « paroisse morte » si boueuse et pluvieuse (il associe souvent le péché à de la boue, – ça doit être en lien avec les souvenirs terribles de la boue et de la mort dans des tranchées de 14-18, si violemment subie par le jeune Bernanos soldat) , on est saisi.
D’abord marqué par le paysage . C’est l’odeur mouillée de la terre, les rafales de vent, la boue des chemins, un horizon de bois, de haies vives, de paysages rincés d’averses. dans le village puis l’odeur de bière dans les estaminets, avec un comptoir des visages durcis par l’indifférence, la résignation. On dirait accoudées au bar , des bêtes rusées, un peu abruties devant un abreuvoir et qui ruminent sans doute un peu de pauvre luxure en lorgnant la serveuse.
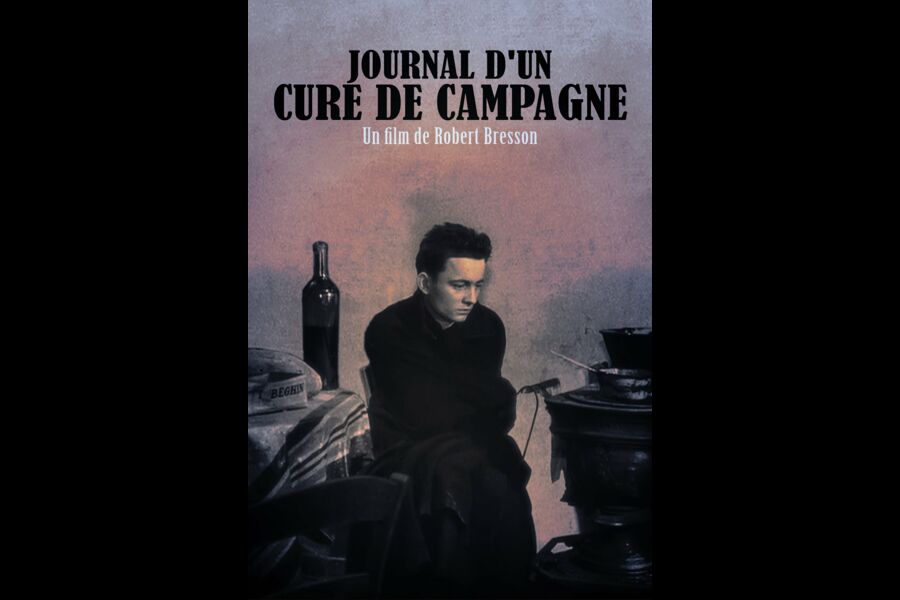
Le curé parle d’un « étang d’eau croupissante », suggérant ainsi que cette paroisse s’enfonce spirituellement et se dissout. L’église la nuit, résonne de vent, de grondements, les portes grincent, et la nef ou la sacristie recèlent tant d’ombres qu’elle devient presque un décor de peur . On frôle le fantastique . Dans les cauchemars et insomnies du curé on devine que pourrait apparaître ce Diable qu’on rencontrait dans « sous le soleil de Satan » . dans ce texte, ni le Diable, ni le divin ne vont apparaître :cette fois le curé fait face à un ciel sans réponse, et que souvent, dans ses pires nuits d’angoisse, il croit vide ; il fait face à une absence . Notre curé avance et tâtonne dans une espèce d’obscurité de plus en plus profonde.d’autant que lorsqu’il rencontre ses paroissiens il avoue : « La paroles que je venais de prononcer me frappaient de stupeur.Elles étaient si loin de ma pensée, un quart d’heure plus tôt ! Et je sentais bien qu’elles étaient irréparables, que je devrais aller jusqu’au bout. « Bref, il ne sait pas adapter son discours à la personne qu’il a en face de lui et multiplie donc les gaffes. Au catéchisme, même malentendu. Les filles ne l’écoutant pas pouffent de rire avec des pensées frivoles. Les parents protestent contre ses décisions. « L’ impureté des enfants » le surprend . Une visite au comte ? « Visite hier au château qui s’est achevée en catastrophe ».Il avoue qu’il ne sait jamais répondre correctement aux questions posées.
Ses rencontres, au lieu de soigner les âmes en difficulté , d’apaiser, aboutissent à des malentendus et souvent à de cinglants échecs. Ce prêtre si disposé à écouter,mains ouvertes, homme de bonne volonté qui espère tant du dialogue avec ses ouailles , lui qui se veut d ‘écoute et de réconfort est renvoyé sans cesse à un monologue,ce sinistre miroir qui reflète ses maladresses met en évidence ses « audaces de timide » qui aboutissent à des catastrophes.
Le ratage le plus spectaculaire reste sa confrontation avec la Comtesse . La mort de son enfant l’a réduite au désespoir depuis des années. Et c’est au cours du difficile dialogue, si brutal,si farouche, si engagé, avec cette Comtesse que le curé confie ceci : ‘j’ai,depuis quelque temps, l’impression que ma seule présence fait sortir le péché de son repaire, l’amène comme à la surface de l’être, dans les yeux,la bouche,la voix….On dirait que l’ennemi dédaigne de rester caché devant un si chétif adversaire, vient me défier en face, rit de moi ». il reçoit même des lettres anonymes.
On pourrait donc penser que ses nuits lui permettent repos, pour reprendre force et confiance et santé. Souvent c’est un moment trouble de mauvais rêves ou de cauchemars. Il multiplie les nuits d’angoisse. « La dernière lampe du village vient de s’éteindre.Vent et pluie.
Même solitude,même silence. Et cette fois aucun espoir de forcer l’obstacle ou de le tourner. Il n’y a d’ailleurs pas d’obstacle. Rien. Dieu ! Je respire, l’aspisre la nuit, la nuit entre en moi par je ne sais quelle inconcevable, quelle inimaginable brèche de l’âme. Je suis moi même nuit. »
Et pourtant, dés qu’il approche de quelqu’un , souvent la personne est prête à se confier. Quand il rencontre l’habile et si protecteur curé de Torcy, il sait qu’il a devant lui une simplicité et une franchise « souveraines », un « faiseur de calme, de certitude, de paix » qui l’aide. Le docteur Delbende , athée lui , un ami qui combat à sa façon l’injustice,les malades les plus démunis, défend les humiliés, payant les dettes des plus pauvres du village et protégeant un braconnier alcoolique, (on le retrouve en majesté , en figure capitale, dans la « nouvelle histoire de Mouchette », ce braconnier..) .Le curé apprend beaucoup de ce genre de médecin apparemment misanthrope . Mais quand le docteur Delbende,chasseur, a été trouvé à la lisière du bois de Bazancourt,la tête fracassée, dans « un petit chemin creux,bordé de noisetiers » ,tué d’un coup de fusil qui fait songer à un suicide, alors curé déstabilisé s’interroge longuement,profondément, sur la médecine, la psychiatrie, la maladie, face à la religion( renvoyant sans doute à sa propre dépression Bernanos qui fut hanté par le suicide) .
Bernanos n’a jamais manqué de mettre en scène un face à face entre un prêtre et un médecin ou un psychiatre, cherchant à situer le point où l’âme humaine est dans la maladie, au sens médiavle ou dans la liberté d’ un combat avec le Mal.Où commencent la pure curiosité psychiatrique froide , avec les mécanismes névrotiques ? Où commence la définition bernanosienne de l’Enfer ? Le curé d’Ambricourt est confronté à ce dilemme face à la mort du Docteur Delbende.un des plus étonnants moments du roman.

Que lui reste-t-il comme arme dans son combat, à ce prêtre ? « Sa seule présence fait sortir le péché de son repaire, l’amène comme à la surface de l’être, dans les yeux, dans la bouche, la voix »
Dans le roman « sous le soleil de Satan » on pouvait rencontrer le diable en personne sur une route de campagne et se battre ,mais dans « le journal d’un curé de campagne », celui qui écrit se bat dans un monde où le néant gagne. Le curé est pris dans des sables mouvants ; un vide l’aspire. Il ne cache pas que la prière est souvent d’un faible secours ou même une angoisse supplémentaire .
La transcendance est parfois balayée. On entre alors -et c’est la puissance du texte- dans une spirale des angoisses , et la position sans point d’équilibre du prêtre ; Il nous fait prendre la mesure de la déchristianisation moderne, qui est en train de gagner les sociétés modernes et le moindre village.
Le curé est confronté à une « grande glaciation ».Inconsolable solitude sur les dalles de la travée centrale, dans la sacristie avec ses murs nus, ou dans le cimetière. Et pourtant dans ses pires insomnies ,le prêtre garde une lumière spirituelle qui accompagne sa silhouette, ses tourments, ses naïvetés ou ses erreurs. »et il parle de « ce grain de poussière rougeoyant de la divine charité » au milieu de « l’insondable Nuit ».
Quel fut l’accueil du livre à l’époque ? En 1936, la critique et le public sont pour une fois unanimes. Plus d’un million d’exemplaires vendus, et un grand prix de l’Académie française le couronne. Les Goncourt ratent le roman au profit de Maxence van der Meersch, avec « L’empreinte de Dieu » . André Malraux a raison de noter l’héritage de Balzac dans la manière, l’écriture, la prose parfois étouffante , et il note aussi l’« influence si évidente de Dostoïevski. Dix ans plus tard les critiques littéraires placent le « journal » dans la liste des douze meilleurs romans du demi-siècle aux côtés de « Les Faux-monnayeurs », « Thérèse Desqueyroux » ou « Un amour de Swann » . Aujourd’hui « les faux monnayeurs » sont, à mon, sens illisblaes et en toc.
Extraits :Bernanos :« Je pense depuis longtemps déjà que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l’indignation qu’éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu’elle s’attire… mais la docilité, l’absence de responsabilité de l’homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public.Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu’il y a de plus en plus d’hommes obéissants et dociles. »
Quelles sont Les sources du roman ? L’enfance de Bernanos dans le pays d’Artois.Il faut savoir que l’exil de Bernanos aux îles Baléares n’a rien d’un séjour de vacances,mais d’un arrachement dans une période de grande pauvreté.
« Dès que je prends la plume, ce qui se lève tout de suite en moi c’est l’enfance, mon enfance si ordinaire et dont pourtant je tire tout ce que j’écris comme d’une source inépuisable de rêves. Les visages et les paysages de mon enfance, tous mêlés, confondus, brassés par cette espèce de mémoire inconsciente qui me fait ce que je suis, un romancier »
« Je ne me console pas d’avoir perdu l’image que je m’étais formé, dans l’enfance, de mon pays. Si je savais où on l’a mise, j’irais crever sur sa tombe, comme un chien sur celle de son maître. ».

« Que serais-je, par exemple, si je me résignais au rôle où souhaiteraient volontiers me tenir beaucoup de catholiques préoccupés surtout de conservation sociale, c’est-à-dire, en somme, de leur propre conservation ? Oh ! je n’accuse pas ces messieurs d’hypocrisie, je les crois sincères. Que de gens se prétendent attachés à l’ordre, qui ne défendent que des habitudes, parfois même un simple vocabulaire dont les termes sont si bien, rognés par l’usage, qu’ils justifient tout sans jamais remettre en question ? C’est une des plus incompréhensibles disgrâces de l’homme, qu’il doive confier ce qu’il a de plus précieux à quelque chose d’aussi instable, d’aussi plastique, hélas ! que le mot. Il faudrait beaucoup de courage pour vérifier chaque fois l’instrument, l’adapter à sa propre serrure. On aime mieux prendre le premier qui tombe sous la main, forcer un peu, et, si le pêne joue, on n’en demande pas plus. J’admire les révolutionnaires, qui se donnent tant de mal pour faire sauter des murailles à la dynamite, alors que le trousseau de clefs des gens bien-pensants leur eût fourni de quoi entrer tranquillement par la porte sans réveiller personne. »
Pour qui voudrait en savoir davantage sur Bernanos, je crois que le mieux est de se procurer « la revue des » Lettres modernes », et surtout les « études bernanosiennes » N° 18, « Autour du journal d’un curé de campagne », textes réunis par Michel Estève.