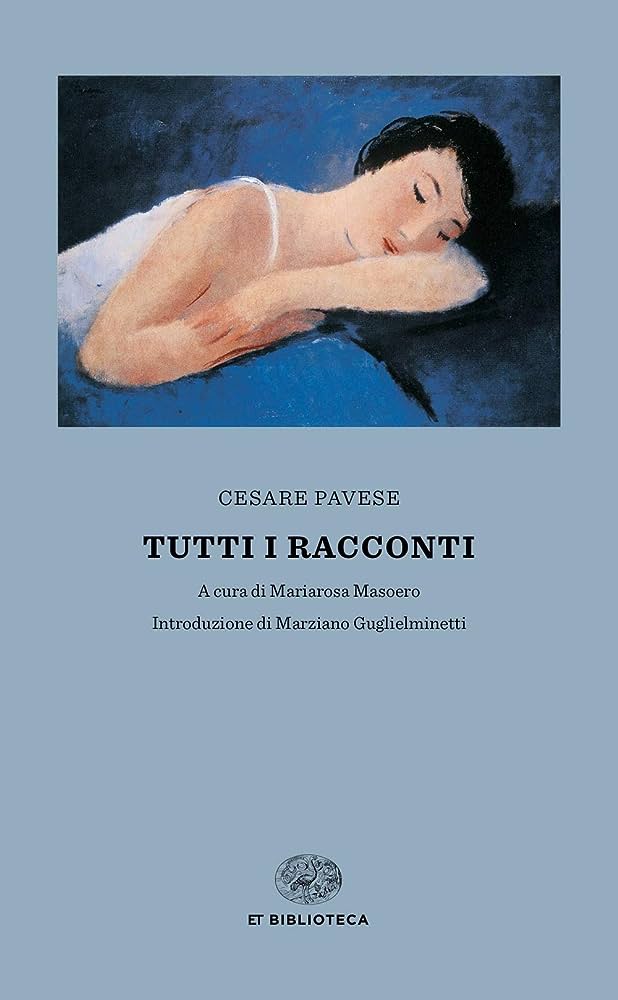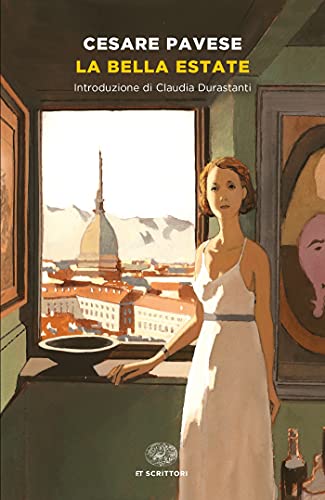Je sortis de l’hôtel Patrizi assez tôt le matin. Laure dormait encore. J’avais laissé la fenêtre ouverte sur la courette et ses lauriers. Je rejoignis la piazza Galeno est sa réverbération éblouissante puis je suivis la viale Regina Margherita en regardant passer les tramways verts, puis traversai la via Nomentana et ses embouteillages du matin. Je marchai jusqu’à la piazza Ungheria Je m’installai comme souvent dans le vaste caffè Hungaria, avec ses grappes de globes blancs, son carrelage géométrique , ses tables sombres miroitantes .

Tandis que je lisais dans le Corriere le énième article sur le problème des ordures que la municipalité de Rome était incapable de résoudre, j’entendis une explosion de verre. A une table proche de l’entrée , une carafe d’eau s’était brisée ,une mère secouait son enfant . J’observais la serveuse en tablier noir, accroupie, en train de ramasser avec une petite pelle les débris de verre. Elle avait des sandalettes blanches qui rappelaient celles que portent les infirmières. Et je notais aussi qu’elle avait des bras nus élégants et fluides, très pâles. Ses gestes avaient une grâce particulière pour ramasser les plus gros éclats. Elle portait aussi à la cheville une petite chaînette en or qui m’intrigua.
Ensuite je parcourus la page des sports et en levant les yeux, m’aperçus que la femme et l’enfant avaient disparu et que la table avait été nettoyée comme si rien ne s’était passé. Comme souvent , je m’étonnais que les gens soient là puis qu’ils disparaissent comme si un magicien les escamotait le temps qu’on avale une gorgée de café.Je me dis: rien n’a eu lieu et cependant une petite parcelle d’or de la mémoire reste en moi et volettera longtemps. ttouite la littérature tend à préserver cette parcelle, à peine un souvenir, à peine une scène de la vie ordinaire.

La serveuse au tablier noir(celle qui avait ramassé les débris de verre) était montée sur un tabouret , prenait des bouteilles d’apéritifs des plus hautes étagères pour les essuyer l’une après l’autre avec soin. .Entra alors dans la salle une grosse femme boudinée dans une robe soyeuse chocolat, ses épaules couvertes d’un châle informe à larges mailles noires semées de fleurs de laine écarlates .Sa coiffure bouclée d’un blond platine ressemblait à une perruque, elle tirait sur la laisse d’un fox terrier qui ne voulait plus avancer. Un couple élégant enjamba le fox terrier comme s’il s’agissait d’un paillasson sale . La lourde femme au visage plâtreux jeta une clé plate sur le comptoir . La serveuse descendit alors de son tabouret ,lui servit un verre de blanc. A la table la plus proche de la mienne, un couple âgé élégant, parlait de la perte d’un ami et de la cérémonie de la crémation à laquelle ils avaient assisté la veille. L’homme, qui tenait serré sa tasse de café brûlant dit : « Je sais bien qu’aujourd’hui le monde n’est plus celui que nous avons connu .mais quand même….cette urne en bronze en forme de flamme.. qui rappelle Mussolini pour notre ami Angelo….Qui a choisi ça?. et l’employée des pompes funèbres qui arrive avec du papier alu tout froissé et qui dit à sa fille.. désolé.il y avait beaucoup plus de cendres que nous avions prévu.. et lui donne le paquet tiède. Tiède.!.». Ayant dit cela le vieil homme fixait l’écume de son café brûlant et je me demandai s’il pensait à sa propre mort et me demandai ce qu’il souhaitait .. et j’avais envie de tout faire pour lui offrir..
Un groupe de lycéens débarqua bruyamment et se regroupa devant l’armoire réfrigérante et ses nombreuses des pâtisseries. Ils ôtèrent tous leurs casques et leurs oreillettes. Et je me demandai soudain si tous ces ces gens d’âges si différents, réunis dans cette vaste salle luxueuse étaient contents de vivre dans leur époque. Et d’abord dans quelle époque vivaient -ils ?La même que la mienne? Sûrement pas. Et moi ? Étais je satisfait de mon époque? sans doute pas mais incpable d’aller opus loin. Sans doute, j’avais e sentiment d’un voyageur d’un certain âge qui revient dans sa ville natale et ne reconnait rien. Le square et la belle allée de tilleuls furent remplacées par des parkings d. Les jeunes femmes du lycée qui te faisaient rêver dans leurs jeans serrés, sont devenues des petites vieilles frileuses trottant avec leur cabas vers une superette, sans regarder les autres. Pourquoi? Incapable de répondre à ces questions, je payai ma consommation et fixai une pile de cendriers en me posant la question de la crémation. Finir dans un cendrier. Les nouvelles générations veulent ça.Je quittai la salle avec le sentiment d’une défaite avec mes questions oiseuses.
Je rejoignis bien plus tard la foule du Corso puis m’engageai dans l‘étroite et populeuse via Frattina . Il était dix heures dix. Je marchai le long de vitrines rutilantes qui ressemblaient à une suite d’aquariums baignant dans une pénombre artificielle. J’étais noyé dans les reflets flous et sombres des passants avançant comme une armée des spectres.Je changeai de trottoir pour marcher au soleil. J’atteignis la place d’Espagne. Rome baigna alors dans un bleu pâle d’une incroyable légèreté. L’ ampleur d’un ciel sans nuage rendait aux coupoles, aux campaniles,aux terrasses fleuries , aux églises leur promesse première sous forme de bénédiction par des anges invisibles.

Via Frattina
Je revins vers l’hôtel en prenant un bus. Il était presque midi .J’étais en retard. Je traversai une place immense et déserte comme un plan d’eau. j’évitai de prendre la Via dei Villini avec ses pins en allées résineuses . C’était là ,devant une villa au crépi vert amande ,que je m’étais disputé jadis ,du temps de ma jeunesse, avec une jeune allemande que j’aimais. Elle voulait voir le Colisée à la nuit tombée . Je détestais cette monstrueuse conque de ténèbres, avec ses trous rocheux , ses voûtes démesurées,ses monstrueux blocs de pierres brunes, cette successions d’ antres obscurs qui puaient l’urine et la mort. Je refusai donc violemment de l’ accompagner.
Je repensai à cet article que j’avais lu la veille dans le Corriere sur l’écrivain Pavese. On y révélait l’existence d’un « carnet secret ». L’écrivain de Turin y avait consigné d’étranges déclarations à propos de sa lassitude du combat antifasciste .il avait multiplié des notes qui ne collaient absolument pas avec ce qu’il affirmait dans ses textes ou déclarait à ses proches. Ce carnet secret, trouvé après sa mort révélait donc un autre Pavese,énigmatique . Son jardin secret.
Et plus j’y pensais ,plus ce jardin secret, m’ intriguait, m’attirait.Dans cette société où tout doit être mesuré, jugé, efficace, constant, et surtout « transparent » , l’expression « jardin secret, » prenait une couleur délicieusement fanée, vieillotte comme si je me promenais dans un verger caché, à l’abandon plein de broussailles , de ronces et de cachettes d’enfance.
Je me souvins alors que l’article précisait que Pavese ne supportait pas de se sentir « visible comme les galets au fond de l’eau » .Je participais,comme lui, à cette effroi de devenir un » galet d au fond de l’eau» que tout le monde regarde .
Je me demandai si mon goût de plus en plus accentué pour le secret,le mensonge par omission, était un symptôme de début de paranoïa et de misanthropie ou, au contraire, un réflexe de santé mentale pour me défendre contre une époque avec son maillage de réseaux sociaux, ses désordres multipliés,ses idées toutes faites, sa confusion et pour tout dire son chaos.
Je revins par la piazza Galeno. L’air brûlait ,les tramways étaient bondés, l’orage couvait , j’étais en retard.

Retour à l’hôtel. Ses tapis rouges , ses hauts couloirs voûtés, blancs ,qui faisait penser à un monastère. La chambre 108 était vide et bien rangée. Je retrouvais Laure assise dans le jardin sous la tonnelle elle avait déplié un plan de Rome sur ses genoux tout en suçotant une branche de ses lunettes.
-Tu as été bien long..
Laure replia le plan et me demanda avec un petit ton narquois :
-Qu’est-ce que tu as fait de ta matinée ?
– Oh.. Pas grand-chose….J’ai flâné..
-Mais encore ?…
-Rien de spécial… Ah si, une carafe d’eau est tombée pas loin de la table où je prenais un café. Tu sais, le café que j’aime beaucoup ..le Caffè Hungaria…
-Oui, je sais, allons déjeuner.