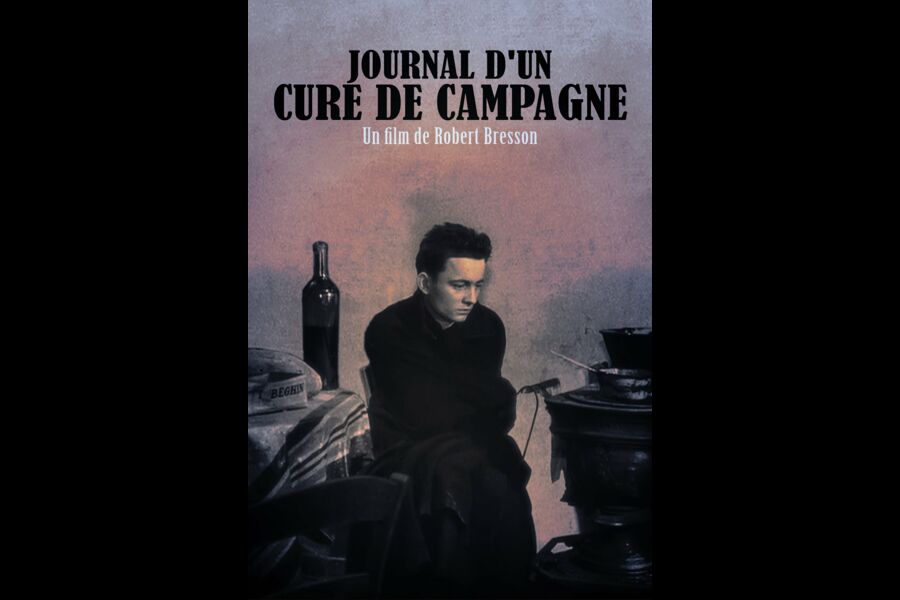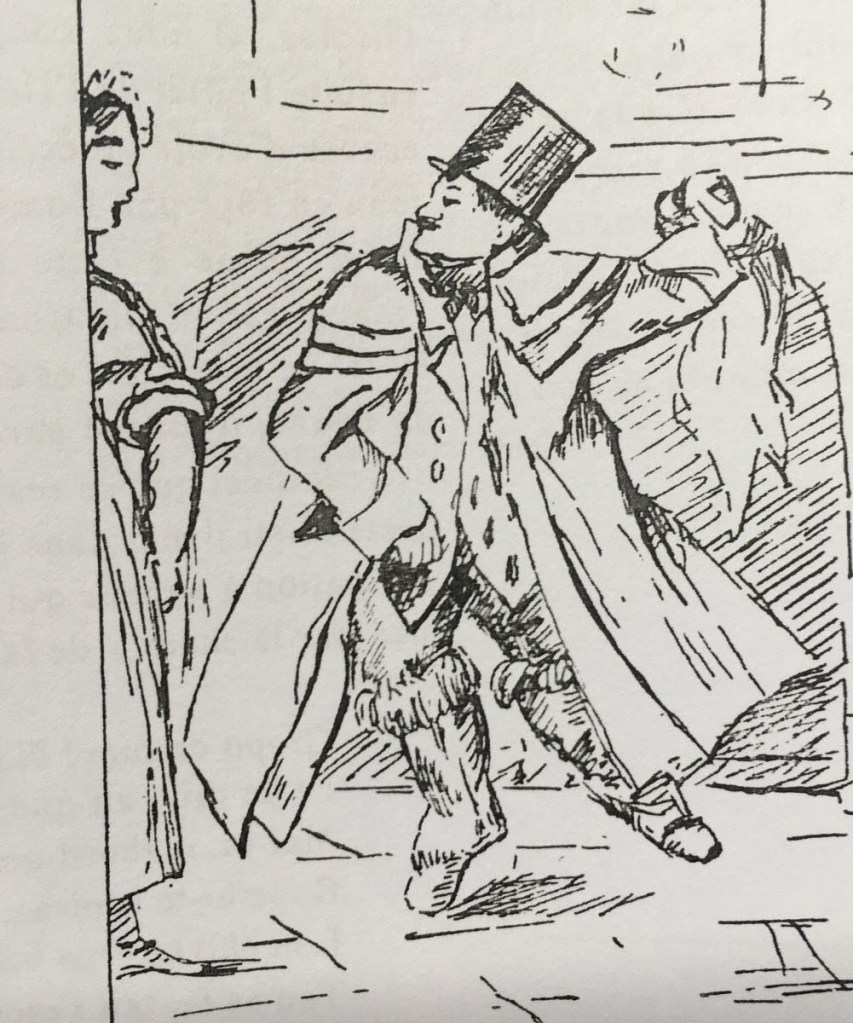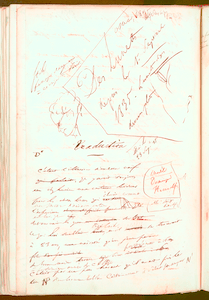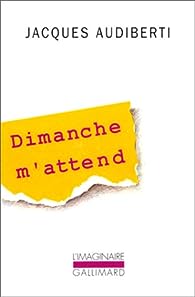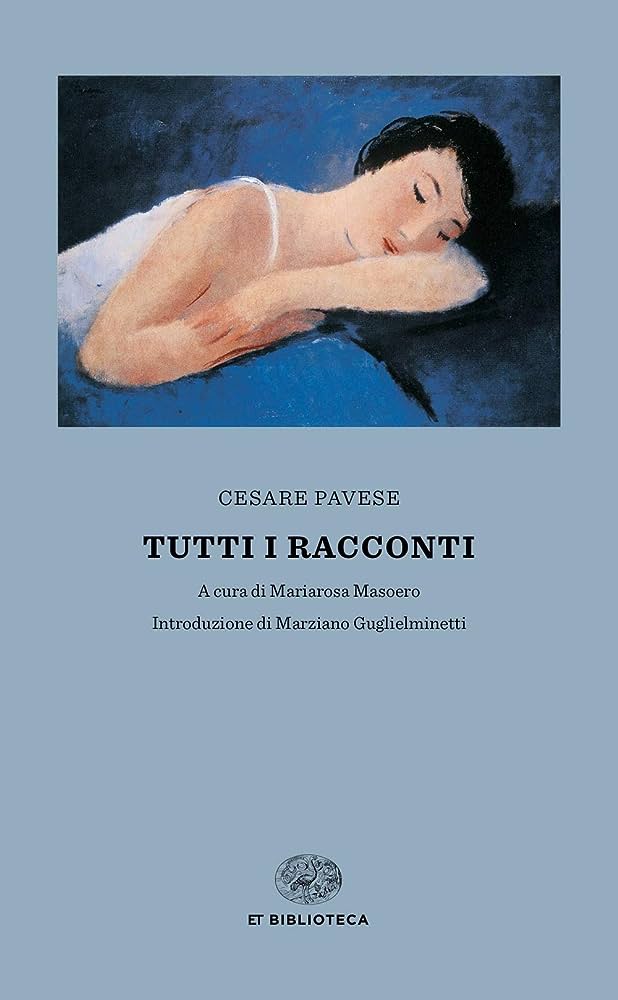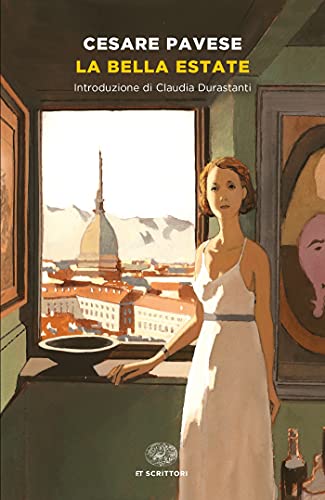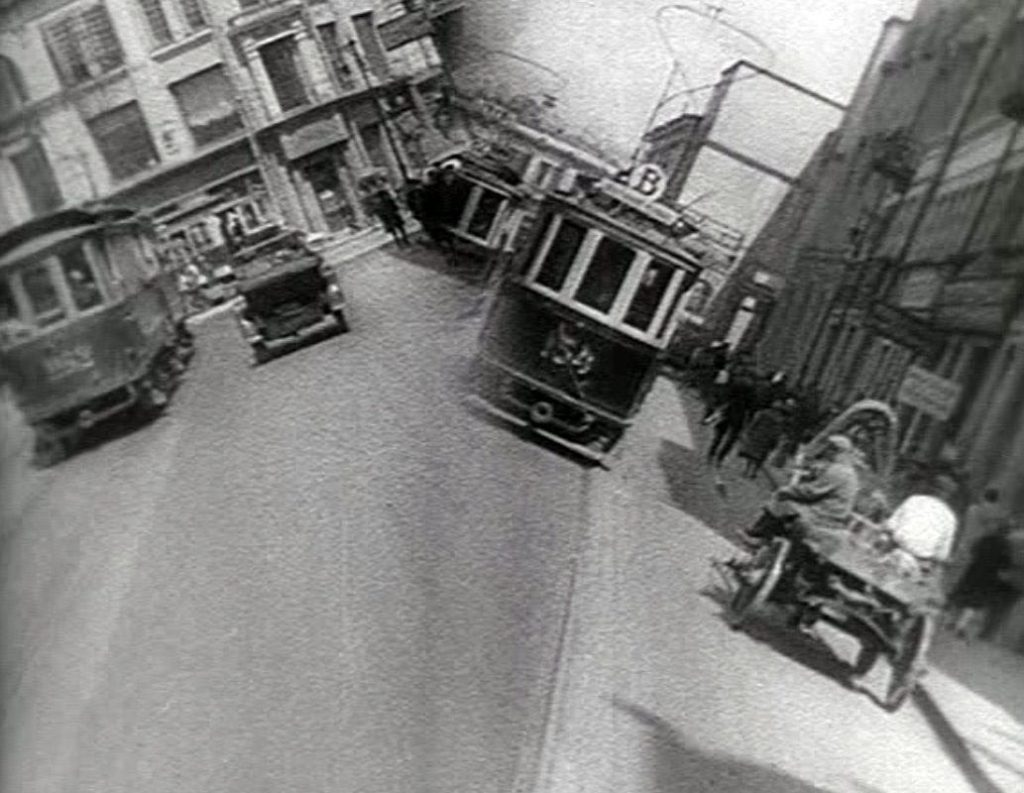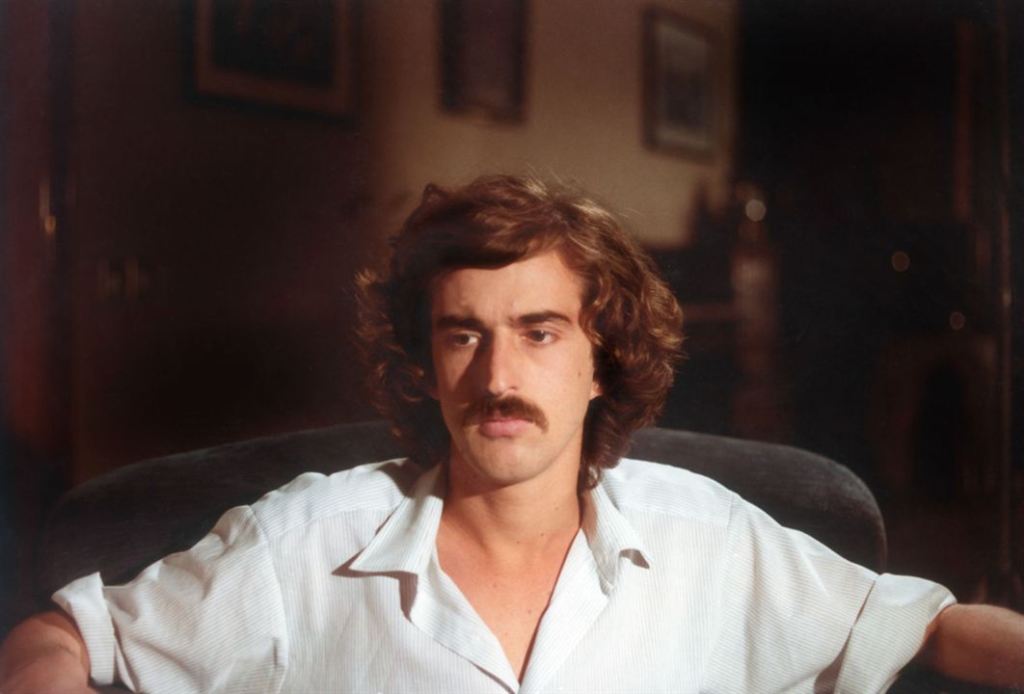J’étais couché sous l’évier de la cuisine pour démonter le siphon. C’est alors que j’entendis de l’autre côté de la cloison une voix de femme :
-Épouse moi ! Épouse moi enfin !!!Norbert épouse moi!!!Merde.
Je reconnus la voix de Claudine,ma voisine qui travaille à la bibliothèque municipale du XIII° arrondissement. C’est une curieuse petite femme grassouillette avec un chignon trop haut. Elle porte des robes d’un jaune canari ou d’un vert cru avec un décolleté qui laisse voir ses seins. L’hiver elle enfile un manteau rose pelucheux qui ressemble plutôt à une robe de chambre. J’aime la rencontrer dans l’ascenseur:elle se tient de guingois et frotte une de ses jambes avec un pied délicieusement orné d’un minuscule tatouage. Elle pose sur moi un regard incandescent et me pose des questions sur mon métier d’écrivain -normal pour une bibliothécaire. J’ai rarement l ‘occasion de répondre car les portes de l’ascenseur s’ouvrent.
J’étais donc en train de démonter avec précaution ce maudit siphon lorsque à nouveau j’entendis :
-Épouse moi !!! Merde c’est dans ton propre intérêt !
Elle ajouta :
-Je suis grasse et belle encore pour cinq ou six ans. Et tu as du pot car j’aurai toujours, en vieillissant, de belles mains blanches potelées et d’admirables paumes pour te faire jouir .

Il y eut un long silence. J’avais enfin trouvé la bonne pince pour dévisser le siphon. Je me demandai où était son mari :dans la pièce à coté ? Dans le couloir? Ou bien elle répétait seule une scène de ménage pour trouver la bonne intonation.
-Et puis merde ,c’est pas moi qui t’ai couru après !!!
J’entendis alors, assez désinvolte et traînante la voix de Norbert, qui travaille à Saclay ou un endroit dans ce genre . Je ne l’apprécie pas vraiment car il porte même en toute saison des pantalons blancs impeccables,une ceinture avec une boucle en forme de serpent et des mocassins blancs à glands.
-Je ne vois pas,dit-il pourquoi tu te condamnes a être malheureuse. Enfin chérie, oui, tu es mer-vei-ll-euse,détends toi, tu es indestructible.
-C’est pour ça que tu te fourres au lit avec ta serveuse le mardi et le jeudi depuis presque un an.
-Ce sont ses jours de marché.
-Il faut régler ça maintenant, tant pis si ça tue notre relation.Tant pis.
Claudine parlait en petites rafales saccadées.
Ma clé à mollette mordait mal sur le siphon.
-Norbert réfléchis je suis la seule à connaître ton anatomie et tes points sensibles. Je t’ai décortiqué comme aucune autre femme ne l’a fait..
-Je ne suis pas un crabe. Tu parles de moi comme si j’étais un crabe.Décortiquer !
-Je connais les points sensibles de ton dos, de t a colonne vertebrale et les zones de plaisir de ton crâne. … aussi bien que.. que..que… que.. la carte de l’Indochine que mon père avait dans son bureau.
Je m’aperçus en démontant le siphon, qu’il était plein de déchets de cheveux gras pris dans une curieuse gelée.
-IL faut régler ça maintenant. Tu m’épouses ou pas ?
-Écoute les enfants vont bientôt revenir…Et les voisins..parle moins fort..
-Dés ce soir tu ne couches plus dans mon lit.
-Notre lit ! Méfie toi des mesures radicales, on pourrait commencer par simplement changer de place. Je peux me mettre à ta gauche,rentrer mon bras, t’acheter un nouvel oreiller,ça facilite la levrette.
-Débarrasse moi d’abord de cette putain de serveuse aux yeux de sole frite.
-Mais pourquoi ? C’est un simple distraction.
-Si tu ne la quittes pas, si tu ne décides pas ce soir ce soir c’ est la valise. Ta valise ! TA valdoche ! Tout sur le palier.. Ton peignoir..tes jeux vidéos de gosse de dix ans.. et tes sculptures morbides en forme de clavicule ou de péroné. Tout sur le palier !Devant les enfants.
-Claudine t’emballe pas.
Il y eut un long silence qui me permit d’extraire d’autres bizarres paquets de déchets trouvés dans le siphon.
Lui :
-Ça fait des mois que je la vois comme une simple distraction,quelque chose d’hygiénique, de sportif, de cool, ni plus ni moins qu’une une partie de tennis ou de pétanque.
-Qu’est-ce qu’elle a de plus que moi ?
-Elle a un corps agréable, oui un corps agréable sans plus , je suis agréable avec elle, elle dit des choses agréables.Son studio est agréable.
-Je ne suis pas agréable ?

-Non. Tu es ardente, voire parfois féerique, inattendue, plein de de cran, imaginative, « décortiqueuse », bouillonnante avec des caresses étranges.
-Tu l’aimes ?
–Elle a un seul défaut , elle est un peu lourde quand elle bascule sur moi, mais ça reste agréable .
-Quitte là ! Maintenant !! tout de suite, téléphone lui !! Téléphone lui ! Devant moi.
-Tu te fais des idées folles Claudine,mon amour. Si tu savais comme elle est agréable. Agréable c’est le mot. C’est le type même de la nana agréable auquel on ne s’attache pas mais qui ne fait pas peur.
– »A laquelle » on ne s’attache pas. Fais au moins des accords grammaticaux corrects Pauvre type.
-Non, elle est douce et calme, c’est ça que je veux dire. Rien de plus.
-Pour le moment je te trouve proprement dégueulasse.
– Faut savoir si je suis propre ou dégueulasse..Elle n’a qu’un défaut , elle ne sait pas bouger ses bras. Elle a de jolis bras mais inertes au moment du.. du… coït . Elle n’a pas d’initiative au moment suprême.
-Suprême ? Au moment « suprême » .C’est le mot qu’utilisait De Gaulle pour dire que les américains débarquaient en Normandie. »Suprême »…J’entends ton père parler.
– Elle ne sait pas où ses bras doivent aller.Mais elle est agréable, crois moi.
Elle est « agréable » comme verre de rosé de Provence, un abricot bien mûr ,un bouquin d’Amelie Nothomb, c’est pas pas une nana idiote.Elle lit beaucoup.
-Tu veux que je te confesse quelque chose ?
-Oui Claudine.
-Que vendredi dernier, je ne suis pas allé à Nanterre voir ma mère mais je suis venue sonner chez ta pétasse pour avoir une explication, la jauger.
-La juger et la condamner.
-Non, connaître ses intentions.
-Quel gâchis.
Il y eut un long silence que je mis à profit pour jeter un coup d’oeil sur le reste de la tuyauterie .
-Claudine laisse-moi un peu de temps, laisse moi encore coucher quelque deux trois fois .que je m’habitue ;;;
Il me sembla entendre quelque chose tomber lourdement sur le parquet , comme un fauteuil avec peut-être un type dedans.
J’étais sidéré par ce bruit si lourd puis des bruits d’efforts suivi d’une respiration pénible et une sorte de râle. Je cherchais un joint neuf dans ma boite à outils .
– J’ai affreusement mal au genou Claudine. Laisse moi m’habituer Claudine. Il y va même de notre équilibre conjugal. Tu vois je te dis tout.. Quand, au bureau je suis énervé,d’une humeur de chien, Lucile m’accueille.Et une heure sur son lit,ou sur la table de la cuisine, suffisent pour que je retrouve le sourire. avec pour finir un whisky et deux glaçons et alors je reviens vers toi détendu, de bonne humeur,frais, dispos, cool, et on baise magnifiquement. Tu vois, je te dis tout. .
Norbert reprit :
-Je te jure son appétit sexuel n’a rien avoir avec le tien. Il est même assez banal .
-Et alors ?
-Le tien est tout sauf banal.. avec des moments inattendus et sidérants avec plein de petits détails coquins.
-Quels moments ? Quels moments ?!!
– Tu as aussi des moments quelque chose de voyou et câlin dans l ‘action ,ou des moments galants. Avec une piété pour mon corps que je reconnais bien volontiers
-Quels moments ?!!
-Eh bien.. quand nous étions dans un hôtel prés de la gare de Perpignan.. tu étais en Perfecto et que tu t’es mise à faire le perroquet.
-Me rappelle pas.
-C’était bien, non ?
-Euh.. T’« es sûr que c’était moi ? Tu sais les amoureux font tous pareils. Faut pas m’la faire à mon âge !
Je crois que Claudine s ‘est mise à chuchoter pour une raison que j’ignore mais qui est sans doute dû au fait que j’ai déplacé ma lourde caisse et que des outils ont dû tinter. Elle a dit quelque chose du genre : « c’était si bon d’être enfant.. » ou « si bon d’être ensemble »je ne sais pas.
La fin de la phrase m’échappa car j’étais en plein effort pour vérifier l’étanchéité du siphon en faisant couler alternativement l’eau froide et l’eau chaude .
C’est à ce moment là que la voix de Norbert devint quasiment inaudible, comme s’il avait changé de pièce.Il me sembla qu’il répétait :
-A quoi bon ? ..à quoi bon..
-A quoi bon quoi ?
-Se marier. ..
-Pour la stabilité,pour les enfants, pour te consacrer à moi.
-Tu vas quand même pas me faire toute une histoire pour une petite voltige avec une serveuse qui m’émoustille. Et si je sortais avec un homme ? Avec un transsexuel libre matin et soir tous les jours? Hein ?
-….
-Il parait que tout se passe pas si merveilleusement bien entre eux. Quand je reviens auprès de toi, tu y gagnes,crois moi.Et puis elle a quelque chose de loyale.
-Epouse moi. J’ai les papiers du mariage.
-Non.
-Pourquoi?
-Les anniversaires de mariage furent si déprimants chez mes parents. Il y avait des bouchées à la reine infectes.
J’ouvris le robinet d’eau froide puis le robinet d’eau chaude (il faudra un jour que j’achète un beau mélangeur) pour voir s’il y avait une fuite . Un peu d’eau perlait au bord du joint.Misère. Immeuble maudit.
Il y eut un long silence , de l’eau perlait sur le siphon. Puis soudain la voix de Claudine,si chaude, si proche du mur que je crus qu’elle s’adressait à moi.
– Mon jugement est fait. C’est une espèce de pauvre connasse qui croit qu’elle aime parce qu’elle secoue son matelas chaque jeudi avec un type qui ne sait même pas se servir de sa bouche aux bons endroits. Mais si tu la quittes,on se marie.
Il y eut comme un gloussement et un froissement et j’imaginai qu’ils glissaient voluptueusement enlacés sur le parquet, près du fauteuil renversé,pour une réconciliation.
On chuchota, on marmonna, on pleura ,mais qui ?
-Tu as des bras merveilleusement souples.
Après un interminable et énigmatique moment de calme, je crus entendre Claudine chuchoter :
– Si nous étions mariés la porte étroite entre mes jambes deviendrait un arc de triomphe. Jamais tu ne te sentiras aussi bien protégé ni avec autant d’assurance. Mariés, nous serons tous les deux blottis définitivement dans un nid de lumière. J’entendis ensuite de longs halètements semblables à ceux de deux coureurs de dix mille mètres en fin de parcours.
Ensuite, alors que je me fatiguais à resserrer les joints du siphon, éclata une effroyable déluge sonore et des voix hystériques germaniques genre Wagner, « L’or du Rhin » ou « Le Vaisseau Fantôme »( je confonds les deux) suivi d’une brutale coupure publicitaire pour des lot de boites de thon au naturel pêché à la ligne chez Carrefour à un prix imbattable. Ils avaient branché la radio.
Donc, réconciliés, me dis-je. Je finis par ranger avec regret ma boîte à outils dans le placard de la salle de bain. Je vérifiai que l’eau s’évacuait bien dans la tuyauterie. J’étais content de mon travail et regrettais de n’avoir pas été bricoleur plus tôt. Quand je pense qu’il y a des gens qui se plaignent que notre immeuble est mal insonorisé.